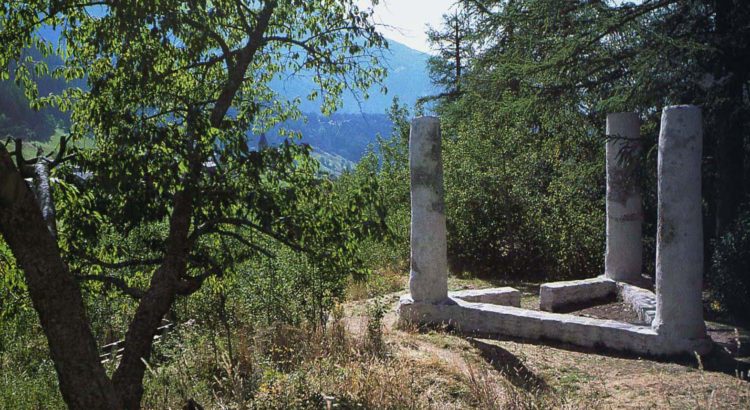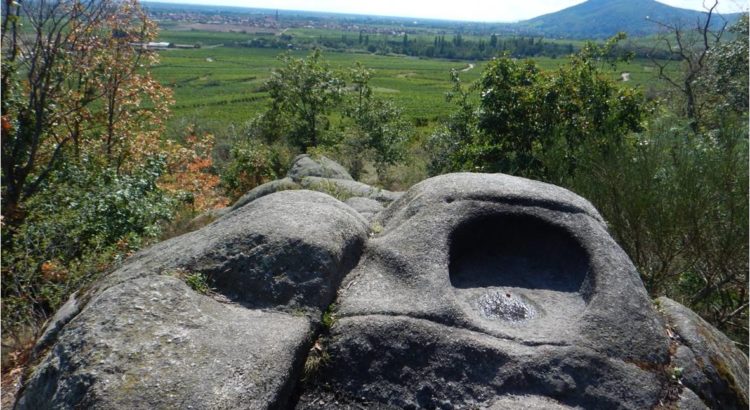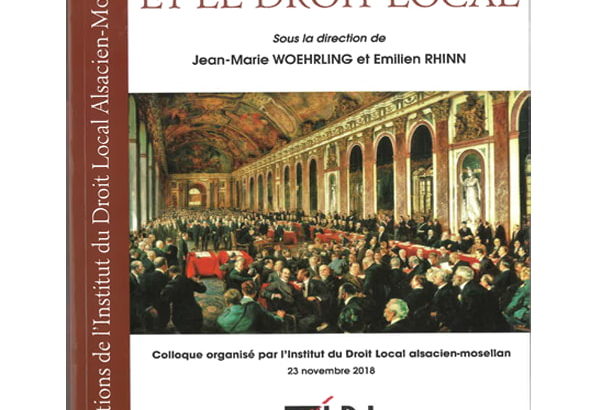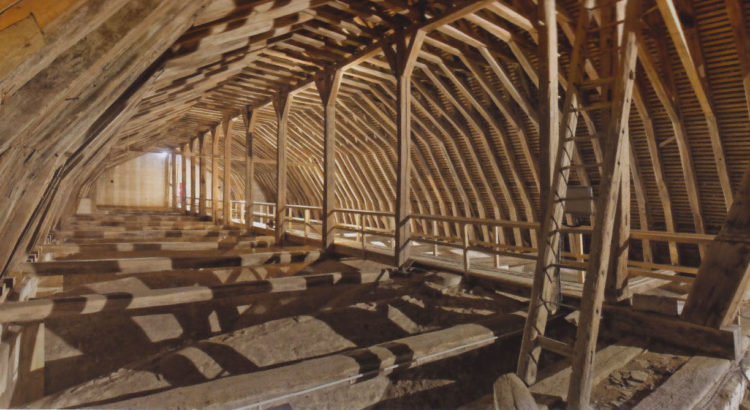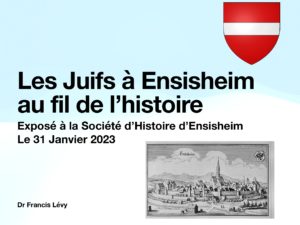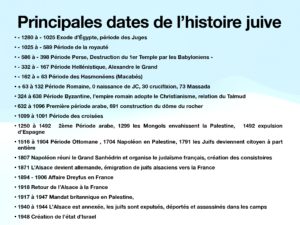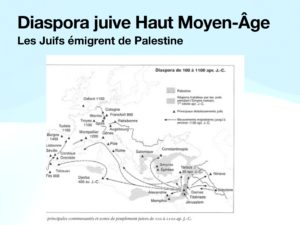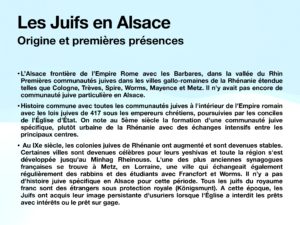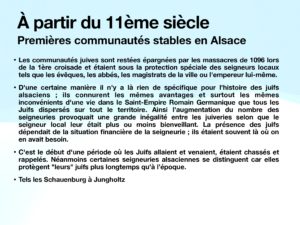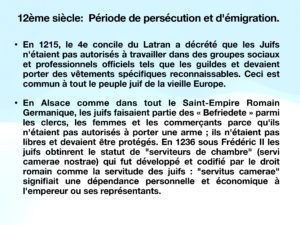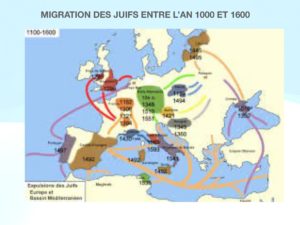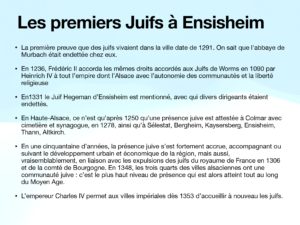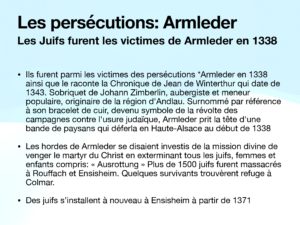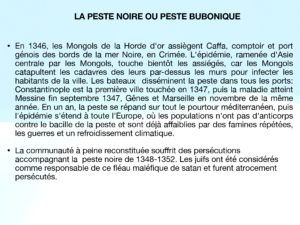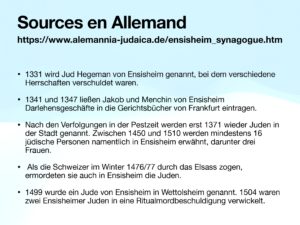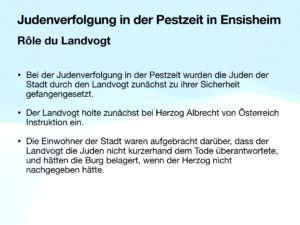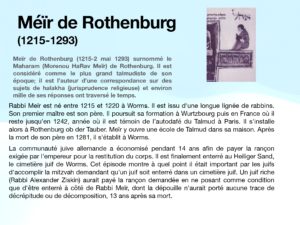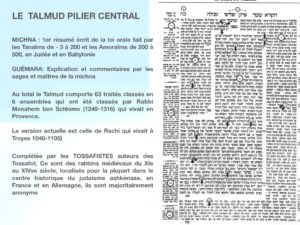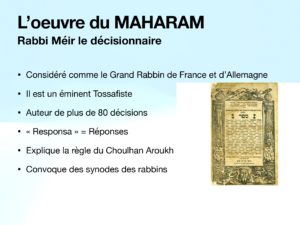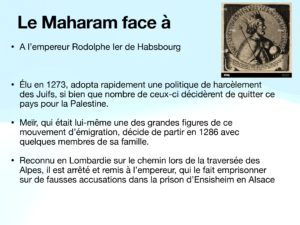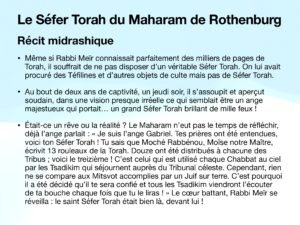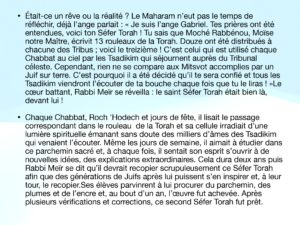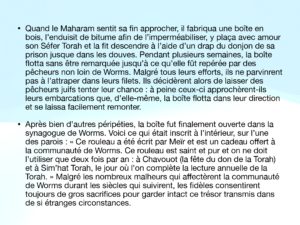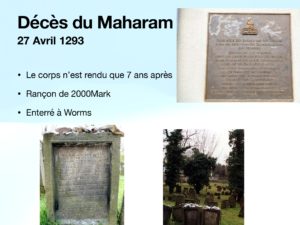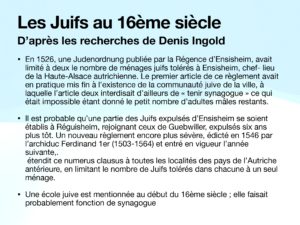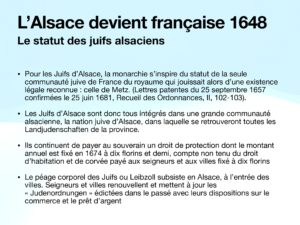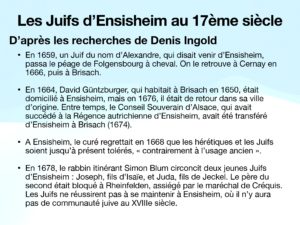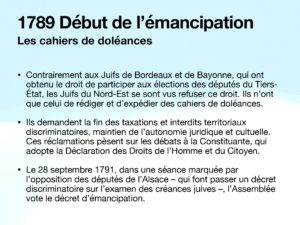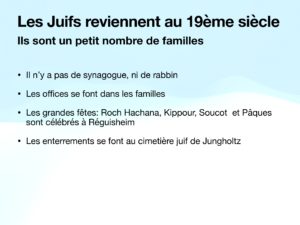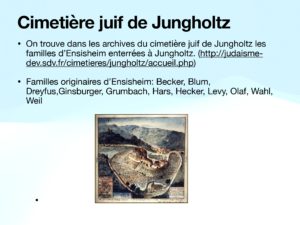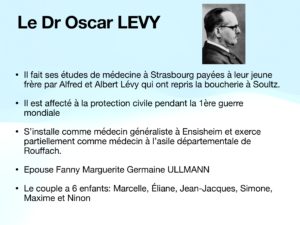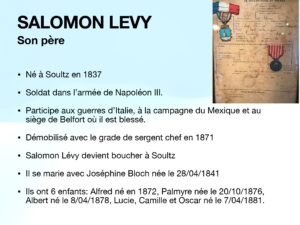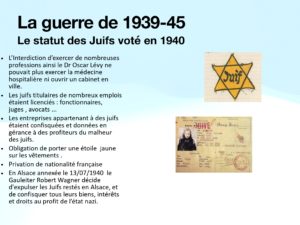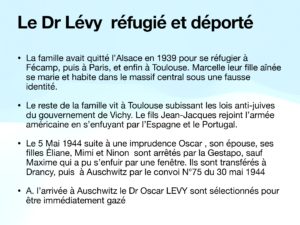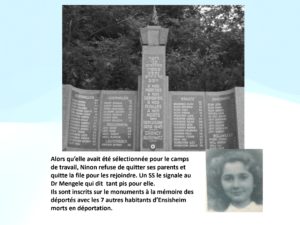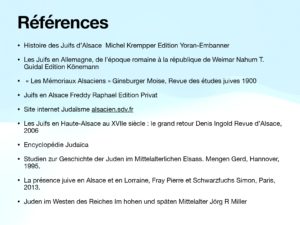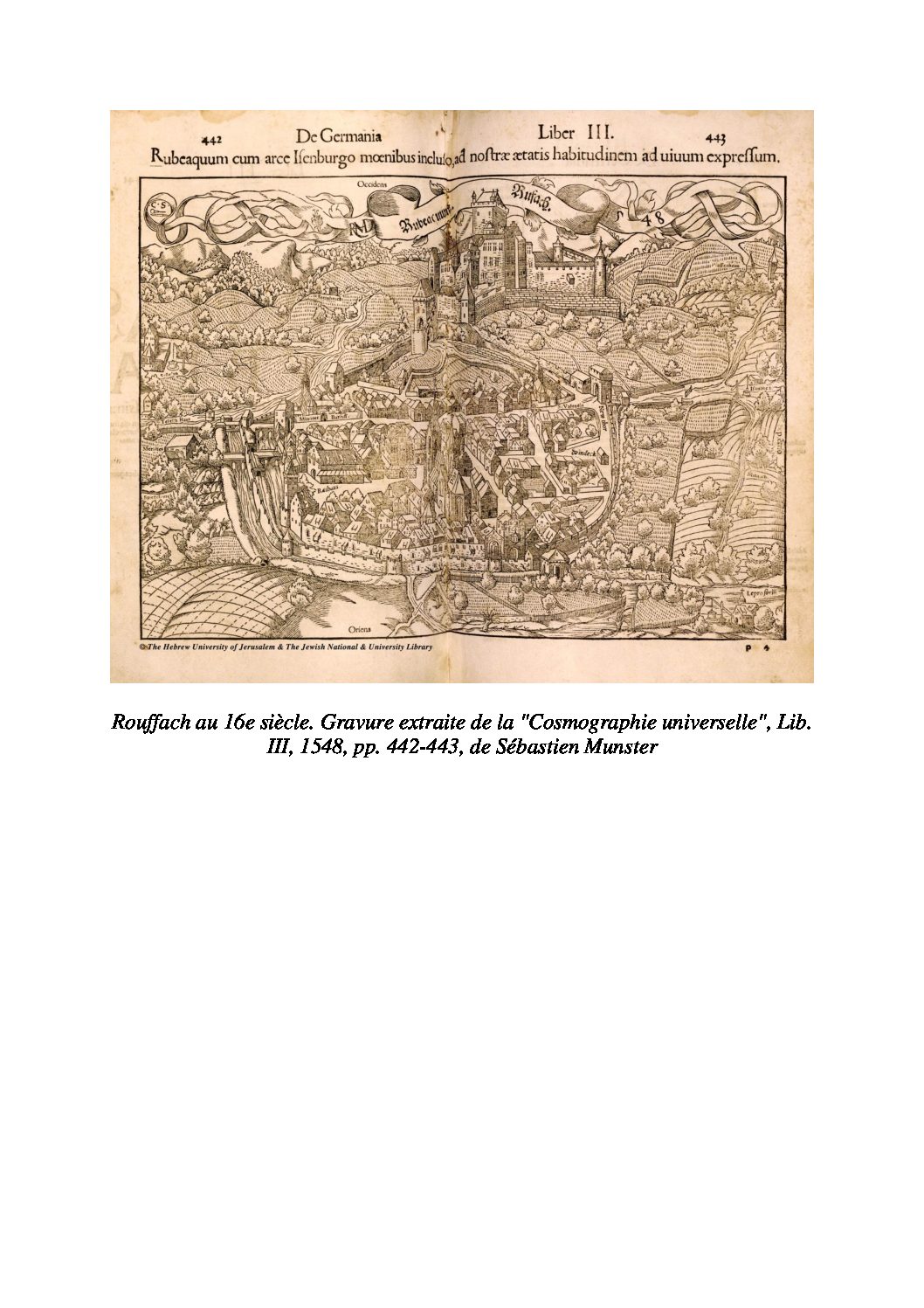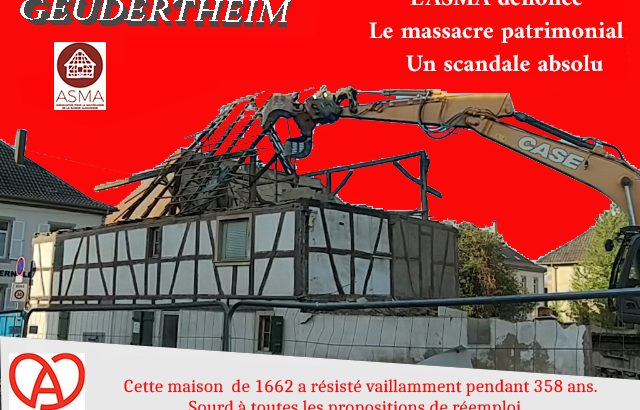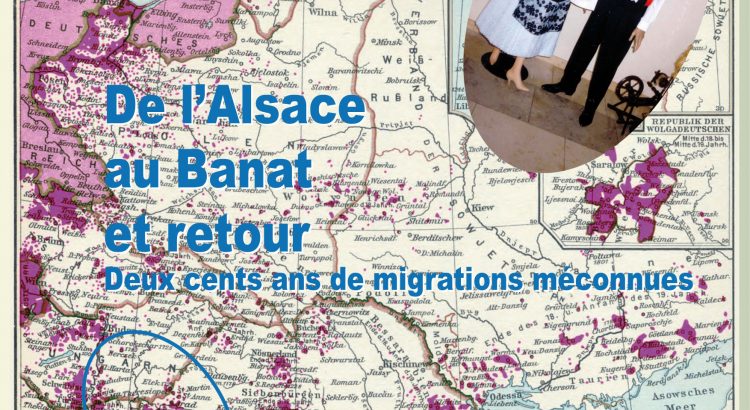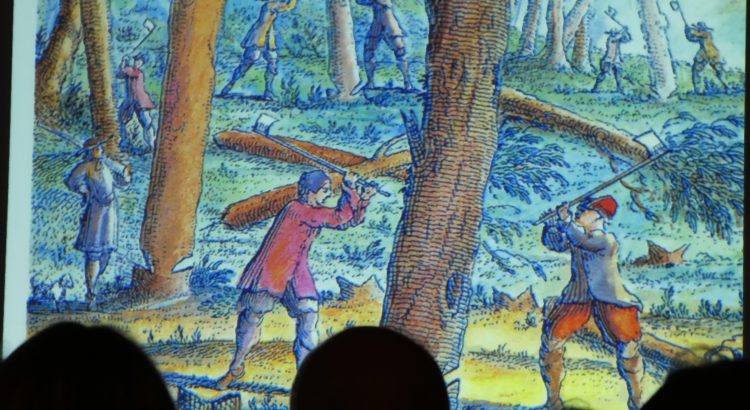Résumé de la conférence du 22 avril 2025: « En marge d’une découverte exceptionnelle de thalers à Ensisheim. Une histoire des trésors de l’Antiquité à nos jours », par Jean-Jacques Schwien, Président de la Société d’Histoire d’Ensisheim.
14 mai 2025

M. Jean-Jacques SCHWIEN
La conférence faisait suite à l’assemblée générale de la Société d’histoire d’Ensisheim et s’est déroulée dans la grande salle du Palais de la Régence, mise une nouvelle fois à disposition par la ville d’Ensisheim.
Lors de son introduction, M. Schwien a évoqué la découverte exceptionnelle de thalers effectuée en 2018 lors des travaux sur le site de l’actuelle médiathèque d’Ensisheim.
Constitué de 154 pièces de monnaie (dont 1/3 de thalers en argent) ce dépôt monétaire a été mis à jour par M. Florent Minot et étudié par «Archéologie Alsace». (Les thalers découverts devraient être exposés de manière définitive après la restructuration prochaine du musée d’Ensisheim)
M. Schwien a expliqué qu’un trésor, c’était un objet dissimulé par une (ou des) personne(s), oublié, puis retrouvé plus tard…
Ce qu’on appelle « trésor » n’est pas forcément composé de matière précieuse, ce peut être un dépôt de haches en bronze, céramiques, livres, etc…
Le conférencier a évoqué les « trésors des clercs », des éléments servant au culte (calices ou vêtements liturgiques) mais dont une partie a été réunie par le clergé dans le but de thésauriser.
Il a donné des exemples (trésor de la cathédrale de Chartres, de Quedlinburg en Allemagne…).
La plupart des objets constituant ces trésors ont traversé les siècles et sont visibles dans les musées ou les lieux de culte ; cependant d’autres ont disparu, car volés ou fondus afin de récupérer le métal précieux.
Le conférencier a ensuite abordé les « trésors des nobles », citant les hanaps en argent de Ribeauvillé, issus de la production des mines appartenant aux Ribeaupierre (vallée de Sainte Marie-aux-Mines), ou les trésors des princes et des rois…
Il a surtout insisté sur les prises de guerre de l’époque de Charles le Téméraire. Les confédérés suisses ont en effet réuni tous les objets précieux trouvés sur le champ de bataille ou dans le campement du Duc pour en faire des sortes de musée à la gloire des troupes qui ont vaincu (trois fois !) le plus grand prince d’Occident. S’appuyant sur une riche iconographie, M. Schwien a en effet expliqué que les nobles avaient souvent au Moyen Âge pour habitude de voyager ou de guerroyer avec leurs objets, principalement ceux qui pour eux avaient de la valeur (chapeaux, oriflammes, tuniques, armures, bijoux…).
Il a mentionné également les trésors enfouis, ceux qui ont été enterrés et que l’on retrouve par hasard quelques années ou quelques siècles plus tard…
Le conférencier a évoqué les tombes recelant de fabuleux trésors, à l’instar de celui de Touthankhamon, le plus connu, ou celui de l’empereur Qin Shi Huang en Chine.
En Europe, il a rappelé que les découvertes suite à des enfouissements n’étaient pas rares (Preuschdorf, dans le Bas Rhin: 7000 pièces de monnaie découvertes; à Wettolsheim 1200 monnaies; dans l’Essonne: 40 000 pièces exhumées; en Bulgarie: près de 80 000 pièces…etc…).
Des objets divers ont également pu être mis à jour, comme de la vaisselle précieuse (plats en argent à Augst, Suisse), des coupes en argent ou des cuillères, à l’hôpital du Mans…etc…
A Colmar, une découverte importante avait été faite en 1863, conservé actuellement au musée de Cluny. Il s’agit d’un ensemble d’objets précieux (bagues, monnaies, coupes, ceinture…) cachés dans un mur, appartenant visiblement à un juif disparu dans la tourmente du pogrom de 1349, suite à l’épidémie de peste noire.
De tout temps, ces découvertes ont stimulé l’imagination et attiré des convoitises.
M. Schwien a présenté une gravure d’un livre des années 1450 sur lequel, au Moyen Âge, il était question «du bonheur de la découverte d’un trésor».
Il a également évoqué les trésors engloutis (dans la mer, ou plus proche de nous, dans les rivières ou fleuves, comme le Rhin, ou ses anciens lits …). Les objets qui apparaissent à l’occasion de dragage, de travaux, ou de prospections, proviennent de naufrages, ou d’offrandes à des divinités.
Le conférencier a expliqué dans quelles conditions les dépôts d’objets précieux avaient pu être réalisés.
Beaucoup de ces enfouissements ont pu être effectué durant des moments de guerre ou d’insécurité (effondrement de l’empire romain, époque des grandes invasions, guerres de Cent ans, de Trente ans…).
Plus près de nous il a évoqué la découverte à Châtenois, Bas Rhin, de bouteilles de champagne enterrées à la hâte à la fin de la seconde Guerre mondiale afin de les soustraire à la convoitise de l’armée allemande, et retrouvées en 1999 à la suite de la chute d’un arbre provoquée par la tempête Lothar.
Le dépôt de thalers découverts à Ensisheim en 2018, datés pour la plupart des années 1630, correspond à l’époque de la destruction de la ville durant la Guerre de Trente ans.
On peut facilement imaginer qu’un habitant ait eu l’idée de soustraire ses économies aux agresseurs en les dissimulant dans une bourse (sans doute en tissu), dans une cachette aménagée sous le plancher de sa Stube, et qu’il n’ait plus jamais eu par la suite la possibilité de récupérer sa fortune…
Le trésor découvert en 1864 aux Trois Epis (exposé au musée Unterlinden à Colmar) provient également de cette période et a sans doute été enfoui dans les mêmes conditions.
Jean-Jacques Schwien a évoqué également les trésors dissimulés parce que les objets qui le composaient n’avaient plus d’utilité (exemple: les objets déposés par la communauté juive dans des lieux appelés «Guénizah»).
Il a évoqué les dépôts liés à des professions (forgerons, artisans du cuir…) ou des objets divers (vêtements, livres) qui n’avaient plus d’utilité et qu’on retrouve aujourd’hui dans les remplissages sous les planchers de maison, sans doute pour servir à isoler des locaux d’habitations…
Terminant son exposé, M.Schwien a abordé la législation concernant les découvertes.
Il a rappelé que depuis une cinquantaine d’années existent des détecteurs de métaux qui ont permis des découvertes, mais que l’usage de ces appareils doit répondre à une législation précise, et qui n’est pas toujours respectée…
L’archéologue étudie chaque objet et s’efforce de comprendre et déterminer à quelle époque, dans quelles conditions et quel contexte ils ont pu être enfouis, perdus ou dissimulés.
Cette connaissance est primordiale et dépasse la valeur des objets.
A l’issue de la conférence, de nombreuses questions ont été posées par un public très attentif auxquelles M. Schwien a répondu.
Un traditionnel verre de l’amitié a suivi la conférence à laquelle avaient assisté environ 70 personnes.
Compte rendu de l’Assemblée Générale du 19 mars 2024
11 avril 2025ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la SOCIETE D’HISTOIRE ENSISHEIM
en date du 19 mars 2024
en la salle de la Régence – place de l’Eglise à ENSISHEIM
La séance débute à 19h20.
1- MOT D’ACCUEIL ET RAPPORT DU PRESIDENT.
Le Président Jean Jacques Schwien salue l’assemblée. Il est très heureux de pouvoir
retrouver les membres et sympathisants dans de ce haut lieu de la Régence rénovée.
Il excuse Mr. le Maire Michel Habig, retenu par d’autres obligations.
La ville est représentée par Monsieur Jean Pierre BRUYERE que le Président
remercie chaleureusement pour son engagement fidèle à nos côtés.
Il remercie également la municipalité pour la mise à disposition de la Régence et
pour le moment de convivialité offert à chacune de nos Assemblées Générales.
2 – PROCES – VERBAL DE NOTRE DERNIERE ASSEMBLEE GENERALE.
Le procès-verbal de cette AG, qui s’est tenue le 11 avril 2023 a été rédigé par
Gabrielle Lammert. Il est en ligne depuis 2023 sur notre site internet, hébergé par le
PLEIADE. Il a été également adressé avec l’invitation à l’Assemblée Générale. Le président
demande à l’assemblée si elle a des remarques à faire. Personne ne se manifestant, ce PV
est adopté à l’unanimité.
3- RAPPORT FINANCIER PAR LE TRESORIER
Notre trésorier, Mr. Philippe Drexler, présente les comptes en détail : recettes,
dépenses, intérêts, solde final.
Pour l’exercice 2023, les réviseurs aux comptes, Madame Sonia GARDINI et Mr. Paul
DEYBER ayant vérifié toutes les pièces justificatives et constaté l’exactitude des comptes,
demandent à l’assemblée de donner quitus au comité pour la bonne gestion. Les comptes
sont approuvés à l’unanimité.
Pour l’exercice 2024, Mr. Paul Deyber et Mme Sonia Gardini sont disposés à assurer
à nouveau la révision de nos comptes. L’assemblée a accepté leur candidature à
l’unanimité et les remercie.
Le maintien de la cotisation annuelle, dont le montant est de 10 € par personne, est
mis au vote et approuvé à l’unanimité.
Le président invite les personnes présentes à s’acquitter de leur cotisation à l’issue
de l’AG auprès du trésorier, soit 10 €.
4 -RENOUVELLEMENT DU BUREAU.
Les membres sortants sont :
Madame Marie Hélène Peultier
Madame Ginette Bailly
Monsieur Jean Luc Isner
Tous les membres sortants sont réélus à l’unanimité pour une durée de 3 ans.
Le président remercie vivement les membres du bureau pour leur investissement et
le travail accompli.
5 -RAPPORT DU PRESIDENT
Le président évoque les projets et préoccupations de la Société d’Histoire.
Pour le bilan 2023, il se réjouit de l’activité accrue de l’association.
Dans le cadre des Journées du patrimoine et en avant-première des manifestations
envisagées pour 2024 sur « Ensisheim au temps des Habsbourg » a été organisée une
conférence à la Médiathèque par Andréa Müller et J.-J. Schwien (22 sept.).
Par ailleurs, les conférences habituelles ont repris leur rythme. Ainsi nous avons pu
accueillir au premier semestre :
* en clôture de l’AG 2023, Bernard Bohly, archéologue, a traité des mines d’argent de
Wegscheid (vallée de la Doller) à la fin du Moyen Âge ;
* Gilles Gable, l’un de nos fidèles membres, nous a fait partager sa passion pour les pierres
à bassin, pierres à cupules (17 oct.) ;
* J.-Jacques Schwien, notre président, a présenté incendies et charpentes des cathédrales
en France (14 nov.).
Le président fait aussi part des avancées sur les nouvelles connaissances sur
l’histoire de la ville, induites par des recherches en cours. Ainsi, les fouilles archéologiques
de la 5e tranche de la zone industrielle, portant au total sur 15 hectares, ont livré des
vestiges majeurs du Mésolithique (Préhistoire) à la guerre de Trente ans.
Les travaux de restauration des remparts de la ville, rue Jean Rasser, ont permis de
revoir la chronologie de la construction de la seconde enceinte : à la différence de ce qu’on
croyait, au moins sur ce tronçon, elle n’est pas due à l’architecte Specklin, vers 1580, mais
est plus ancienne. Le rapport précisant ces données nous en fera sans doute savoir
davantage. Un beau fragment d’une sculpture en remploi, paraissant représenter le blason
des Habsbourg (le cimier avec des plumes de paon), a également été dégagé et réinséré
dans le parement.
Enfin, la seconde tranche des travaux de la Régence, portant sur la charpente et les
arcades est aussi susceptible de compléter les connaissances sur le monument, en
particulier avec les prélèvements pour des datations dendrochronologiques et le relevé
systématique des marques de tacherons. Là encore, les données seront apportées par le
rapport archéologique.
Les activités envisagées pour 2024 sont exceptionnellement riches.
Pour le premier semestre, nous avons trois conférences :
* Claude Muller (Université de Strasbourg), Splendeurs et misères du vignoble
alsacien à travers les âges (30 janv.)
* J.-Marie Woehrling (président de l’assocation), Le Droit Local en Alsace-Moselle (27
fév.)
* J.-Michel Rudrauf (archéologue), La construction en pierre dans les châteaux
alsaciens (19 mars, à la suite de notre AG).
Comme à l’accoutumée, nous participerons aussi à KALISTOIRE au mois de juin,
grâce à l’implication de Maurice Gardini.
Pour les Journées du Patrimoine, nous proposerons exceptionnellement une sortie à
nos membres, en lieu et place des manifestations organisées habituellement sur place.
Nous nous rendrons le 21 septembre à Wintzfelden pour découvrir le travail de
recherches et mise en valeur du couvent de Schwartzenthann par l’équipe de bénévoles.
Mais ce sont avant tout les manifestations « Habsbourg » qui vont nous accaparer.
Notre ville s’apprête en effet à vivre une année mémorable à la recherche de son passé de
siège des territoires patrimoniaux des Habsbourg dans le Rhin supérieur.
Déjà, nous avons pris part aux récentes festivités commémorant le mariage de
Jeanne de Ferrette avec Albert de Habsbourg à Thann en 1324. Parmi les éléments
saillants, on peut citer l’A.G de la Via Habsburg (16 mars) tout comme la grande
manifestation ponctuée par la visite d’Albert de Monaco (17 mars).
Toutefois, ce sont nos propres manifestations qui, en collaboration avec la Ville
d’Ensisheim, vont mobiliser les forces vives de la SHE tout au long de l’année 2024.
Un comité d’organisation a été constitué. Il réunit la Ville (J.P. Bruyère, Emilie
Cristen, Stéphane Esquirol), l’Alemannisches Institut de Fribourg, Andrea Müller (Bâle) et
la SHE (avec Francis Hans comme cheville ouvrière).
Il a d’abord travaillé à la recherche de documents, en relation avec les musées de
Spire, Innsbruck, Belfort , Bâle, Porrentruy. Des visites ont été organisées et de nombreux
contacts fructueux engagés.
Un programme ambitieux a été élaboré, se déclinant en 4 chapitres principaux.
Une forte implication des écoles (17 classes de l’Ecole des Mines, de Jean-Rasser et
du collège) permettra d’avoir des spectacles et autres manifestations livrant le regard de
nos jeunes sur l’histoire des Habsbourg et le Moyen Âge en général (oct.-nov.).
Une Marche de l’Histoire impliquant la Région Grand Est invitera nos concitoyens
mais aussi de nombreux bénévoles d’Alsace et d’ailleurs à découvrir le patrimoine
urbain et rural lié à notre histoire (19 oct.).
Une exposition avec de nombreux documents sur Ensisheim entre 1200 et 1700 se
tiendra à la Régence (12 oct.17 nov.). On y verra en particulier la copie d’une grande statue
en bois de Maximilien, acquise récemment par la Ville mais aussi une maquette du château
(en cours d’élaboration par J.-Luc Clausse).
Un colloque international, intitulé « Ensisheim et les Habsbourg » clôturera le tout à
la Régence (15-16 nov.).
6 – PRISE DE PAROLE DE MR J.-PIERRE BRUYERE, AU NOM DE LA COMMUNE
Monsieur Jean Pierre Bruyère nous dit combien il est heureux d’assister à notre
Assemblée Générale et se félicite de la belle collaboration entre la SHE et la Ville qui s’est
engagée autour de la thématique des Habsbourg.
Les réunions hebdomadaires qui y sont consacrées permettent de mieux se
connaître et de développer nos complémentarités.
Il ne cache pas que toutes ces manifestations auront un coût important, porté par la
Ville mais avec des aides de la Communauté Européenne d’Alsace (CEA), la Via Habsbourg
et le Land Bade-Wurttemberg (via l’Alemannisches Institut). Mais il pense que cela
apportera un rayonnement considérable à Ensisheim. Il est particulièrement heureux du
côté ludique et pédagogique qu’apportera la participation des scolaires tout comme du
« retour » de Maximilien à Ensisheim, avec la statue réalisée à Innsbruck.
Il annonce aussi le projet engagé par la Ville d’une BD sur Ensisheim aux Editions du
Signe (5000 exemplaires), relatant l’histoire de notre ville du Paléolithique jusqu’à
l’exploitation de la potasse.
Pour annoncer ces manifestations et d’ailleurs rendre durable la visibilité de notre
passé habsbourgeois, il nous fait part enfin de la mise en place en cours par la municipalité
de très beaux logo « ENSISHEIM VILLE D’HISTOIRE-VILLE D’AVENIR – Cité des
HABSBOURG » à chaque entrée de la ville.
En conclusion, J.-Pierre Bruyère réitère ses félicitations à notre société et formule le
souhait que nos entreprises communes trouvent le succès qu’elles méritent, ce dont il est
entièrement convaincu.
Le Président le remercie pour ces paroles et l’écoute qu’il a à notre égard. Il souligne
combien il est important de partager la même passion de l’histoire.
Le Président remercie également l’ensemble des membres du comité pour leur
travail et l’ensemble des participants pour leur soutien actif.
Il clôt l’Assemblée Générale à 20 H 20 et invite l’assistance à participer à la
conférence de J-Michel Rudrauf : La construction en pierre dans les châteaux alsaciens.
Fait à Ensisheim, le 22 mars 2024
Le Président La Secrétaire
Jean Jacques SCHWIEN Gabrielle LAMMERT
Résumé de la conférence du 21 janvier 2025: « Du camp de concentration à l’espace mémoriel: étude archéologique du camp de Natzwiller-Struthof », par Mme Juliette BRANGE et M. Michaël LANDOLT.
13 mars 2025

Mme Juliette BRANGE et M. Michaël LANDOLT, les deux conférenciers
« Du camp de concentration à l’espace mémoriel : étude archéologique du camp de Natzwiller-Struthof »
Le palais de la Régence, mis à disposition par la ville d’ENSISHEIM a accueilli mardi 21 janvier 2025 la 1ère conférence de l’année proposée par la Société d’histoire devant une assistance composée d’une trentaine de personnes.
Les deux intervenants conférenciers, Mme Juliette BRANGE, doctorante à l’Université de Strasbourg, et M.Michaël LANDOLT, directeur du camp du STRUTHOF, ont exposé les résultats de leurs recherches. Ils travaillent depuis plusieurs années sur le camp de concentration du STRUTHOF et y ont étudié l’économie de guerre à l’époque nazie.
Ils se sont appuyés tous deux sur les témoignages d’anciens déportés, et ont tenté de déterminer le profil des détenus durant cette période.
Le camp de concentration a servi à l’internement des déportés majoritairement politiques jusqu’en 1945, mais ensuite a été utilisé comme prison jusqu’en 1949, date à laquelle il est devenu « espace mémoriel ».
Si le site du STRUTHOF est bien connu pour ses deux sites principaux (« le camp haut » et « le camp bas »), on ne savait pas grand-chose jusqu’à une époque très récente de « l’espace de la carrière » situé à proximité, sur lequel ont porté l’essentiel des travaux des deux conférenciers.
Les travaux archéologiques de Mme BRANGE et de M. LANDOLT ont débuté en 2018, ils ont porté sur le recueil des témoignages des anciens déportés, la fouille de l’ancienne carrière a commencé à partir de 2020.
Leurs études ont mis en avant au départ un travail de prospection de la part des nazis, pour s’assurer que le site de la carrière de granite serait exploitable. Le but étant de construire le camp de concentration avec des matériaux situés à proximité, et éventuellement de contribuer à fournir le Reich en pierres de qualité pour construire ses monuments gigantesques. (A ce sujet, les matériaux n’ont semble t’il pas répondu aux critères exigés, et n’ont sans doute pas été employés au-delà du site du camp ou de destinations proches…).
Les premiers sondages au niveau de la carrière ont eu lieu en 1940, et l’accueil des prisonniers a été effectif à partir de 1941.
La carrière du STRUTHOF a produit essentiellement des matériaux de type « gravier », ainsi que des pavés ou des pierres pouvant servir de marches d’escaliers, par exemple, qui ont été utilisés pour aménager le camp.
Les chercheurs s’efforcent de comprendre aujourd’hui quels étaient les bâtiments existants et leurs fonctions.
Sous les ruines actuelles au niveau du site de la carrière, leurs recherches mettent en évidence des aménagements divers qui ont servi à l’exploitation passée, ainsi qu’à l’organisation des activités…
Si l’extraction des pierres était l’objectif au départ du chantier, il est à noter que d’autres fonctions ont été engagées par la suite.
Les fouilles effectuées ont permis de comprendre l’évolution des activités sur une période de plusieurs années. Elles sont particulièrement importantes pour compenser la destruction partielle des archives du camp.
Sous les gravats et les ruines du site, des structures ont été dévoilées, mettant à jour les différentes occupations.
Des chutes de métal, de scories, de particules métalliques, des traces d’outils… ont été découvertes, qui traduisent un changement dans l’utilisation du site.
Il est établi qu’à partir de 1943 , le site des carrières a accueilli des machines-outils, ainsi que des forges dont la fonction était de réparer et d’assurer la maintenance de moteurs d’avions (moteurs « Jumo 211 » qui équipaient les avions de type « Junker »).
Les fouilles tentent de déterminer à quels usages pouvaient servir les structures disparues et quelles en étaient leurs dimensions.
Il est certain qu’une activité de forge avait été organisée sur le site des carrières.
Des interprétations peuvent être effectuées au travers des objets mis à jour (objets métalliques divers, éléments de simili cuir…), et identifiés au travers de la méthode du carroyage (quadrillage du sol).
Des déchets de foyer dans lesquels scories, particules métalliques, traces d’outils…sont également étudiées et permettent de comprendre la chaîne opératoire.
Au travers de leurs recherches, Mme BRANGE et M. LANDOLD s’efforcent également d’évaluer quel était le nombre de prisonniers affectés aux différentes tâches, quelles étaient leur nationalité, ainsi que leur niveau de formation requis.
Mais parallèlement au travail forcé, il a été établi que des ouvriers « civils » étaient eux aussi affectés sur le site du STRUTHOF pour encadrer techniquement les prisonniers.
Les chercheurs essaient également de comprendre quel pouvait être le degré de relations entre personnel « libre » et « travailleurs forcés »
Des éléments tentent à affirmer qu’il pouvait exister parfois une forme de sympathie entre eux..
Mme. BRANGE et M. LANDOLD ont pu recueillir au travers de leur travail d’enquête des témoignages récents d’anciens ouvriers, pour la plupart habitants des villages voisins (LA BROQUE, NATZWILLER…), ayant été employés sur le site des carrières. Certaines de ces personnes aujourd’hui disparues ont pu confirmer, tardivement pour la plupart (sans doute parce qu’elles ne souhaitaient pas être soupçonnées de collaboration), qu’il existait des relations d’amitié entre elles et certaines personnes détenues.
Les dons en faveur du musée du STRUTHOF qui sont effectués depuis plusieurs années (les descendants des différents acteurs de cette époque ont pris conscience de la valeur en tant que témoignage des différents objets déposés) permettent également d’augmenter les connaissances sur le fonctionnement de ce camp.
.
Il est à noter que le site, qui a servi de camp de détention après la guerre, a été considérablement dégradé de manière volontaire dans les années 1970. Les matériaux divers (bois, métal, graviers…) ont non seulement été réutilisés, mais une grande partie des anciens bâtiments a subi le passage des engins de chantier de type « bulldozer », afin de tenter d’effacer à tout jamais les souvenirs douloureux du site…
Aujourd’hui, le devoir de mémoire s’impose, et il est essentiel de transmettre la connaissance des événements douloureux d’une époque récente qui pourraient tomber dans l’oubli.
Les travaux des deux chercheurs se poursuivront dans l’avenir, certaines parties du site n’ont pas encore été fouillées (dépotoirs..) et devraient livrer d’autres éléments qui permettront d’alimenter nos connaissances sur ce sujet.
Des questions ont été posées à la suite de la conférence, auxquelles les deux conférenciers ont répondu bien volontiers.
Le débat s’est ensuite poursuivi au travers du traditionnel verre de l’amitié
de transmettre la connaissance des événements douloureux d’une époque récente qui pourraient tomber dans l’oubli.
Les travaux des deux chercheurs se poursuivront dans l’avenir, certaines parties du site n’ont pas encore été fouillées (dépotoirs..) et devraient livrer d’autres éléments qui permettront d’alimenter nos connaissances sur ce sujet.
Des questions ont été posées à la suite de la conférence, auxquelles les deux conférenciers ont répondu bien volontiers.
Le débat s’est ensuite poursuivi au travers du traditionnel verre de l’amitié.
Résumé de la conférence du 25 février 2025, par M. Angelo PONZE: « Gibets, cachots et mise à la question »
12 mars 2025

M. Angelo PONZE
Résumé de la conférence du 25 février 2025
La SHE remercie la ville d’Ensisheim d’avoir bien voulu mettre à disposition la salle du Palais de la Régence pour sa 2éme conférence de l’année.
Une quarantaine de personnes sont venues assister mardi 25 février 2025 à la conférence de M. Angelo PONZE, titulaire d’un master en archéologie, sur le thème:
«Gibets, cachots et mise à la question. Archéologie des lieux de justice en Alsace, du Bas Moyen Age à l’époque moderne (1300-1800)».
Dans un premier temps, M. PONZE s’est efforcé de définir la thématique:
«Un lieu de justice, dans le cadre de l’archéologie, correspond à un site, une structure ou un environnement ayant été, à une époque , soumis à l’autorité d’un pouvoir régent, qui l’a modifié ou structuré à cette fin» (lieu d’enfermement ou d’exécution).
Le conférencier dans ses recherches s’est appuyé sur plusieurs ouvrages ayant déjà traité du sujet, tels que «Surveiller et punir» (Michel Foucault), «Crime et châtiment au Moyen Age» (Valérie Toureille), «Enfermements», «les espaces carcéraux au Moyen Age» (Elisabeth Lusset), etc.
Il a étudié l’iconographie des différents lieux d’enfermement, et a relevé de nombreux détails pouvant informer sur les conditions de détention au travers de la période évoquée (durée de la détention, conditions de vie des prisonniers, nourriture…)
M. PONZE a étudié certains sites connus pour ayant abriter des geôles tels que la porte basse de l’enceinte de Mutzig, celle de Dambach-la-Ville, la tour des Bouchers à Ribeauvillé, la tour des sorcières de Sélestat, les tours des Ponts-Couverts de Strasbourg…
Chacune de ces structures porte encore aujourd’hui le témoignage de son utilisation en tant que lieu de détention autrefois.
Il a identifié les endroits révélant des traces d’ anciennes cellules (barreaux, empreintes de cloisons….), a noté leurs dimensions, a constaté qu’il existait parfois des graffiti ( en nombre très important parfois) réalisés de toute évidence par des prisonniers. Il a aussi relevé les indices qui témoignaient d’un système possible de chauffage (poêle), et a obtenu parfois des éléments concernant les literies ou la nourriture attribuée aux prisonniers.
M. PONZE a abordé ensuite le thème de la torture, et a expliqué qu’il s’était appuyé sur les ouvrages du type «Procès de la sorcellerie au Moyen Age» , ou «l’holocauste des sorcières d’Alsace», ouvrages de Jacques Roehrig.
Il a décrit le système de l’estrapade utilisé entre autres dans la tour des Voleurs à Riquewihr après en avoir étudié le fonctionnement. Le conférencier a noté que le système de cette forme de torture était codifié et que l’interrogatoire des personnes concernées ne se faisait pas au hasard.
M. PONZE a terminé ensuite sa conférence en évoquant les lieux qui ont accueilli des exécutions par pendaison, sur lesquels était donc édifié un gibet.
Il a expliqué qu’il s’était penché au travers de ses recherches sur l’iconographie, mais également sur la toponymie des lieux (Galgenberg), ainsi que la carte de Cassini où certains indices notés « Justice» lui ont été précieux pour déterminer où étaient situés et comment étaient conçus ou utilisés ces lieux d’exécution ( Benfeld, Landser, Bouxwiller,etc…).
Le conférencier a développé son étude en s’appuyant sur une centaine d’illustrations, photographies ou tableaux explicatifs qui ont rendu l’écoute attrayante.
A la fin de la conférence, un débat avec le public a eu lieu, M. PONZE a répondu volontiers aux questions posées.
Les discussions se sont ensuite poursuivies autour du traditionnel pot de l’amitié.
Conférence du mardi 17 octobre 2023, par M. Gilles GABLE, historien : « Pierres à bassins, pierres à cupules. Des pierres Mystérieuses décodées ? »
26 avril 2024C’est dans la grande salle de la médiathèque mise à la disposition de la Société d’Histoire par la municipalité d’Ensisheim qu’a eu lieu la conférence donnée par M. Gable.
Le public venu nombreux a écouté avec attention l’exposé du conférencier.
![]()

M. Gilles GABLE
- GABLE, ingénieur en électronique de formation, est passionné depuis de nombreuses années par les mégalithes et pierres à cupules qui, de tout temps, ont pu susciter des interrogations.
Si nous savons que les menhirs et dolmens ont été construits ou élevés par les hommes, nous ne connaissons pas la signification des pierres dites « à cupules » qui auraient également été façonnées par des mains humaines…
Le conférencier a pu constater au travers de ses recherches que les excavations dans les pierres et rochers avaient différents diamètres ; il les qualifie de « cupules » lorsque celles-ci sont inférieures à 10 cm, et de « bassins » lorsqu‘elles sont de dimensions plus importantes.
- Gable a précisé que l’on pouvait rencontrer ces pierres remarquables dans de nombreux endroits de notre région ( Grand Hohnack, Taenchel, Dieffenthal…),mais également ailleurs en France (Lozère, Aubrac, Monts du Forez,Morvan…), ainsi qu’en de nombreux endroits du monde ( Portugal , Karahan Tépé, Gobekli Tepe, en Turquie…).
Depuis de nombreuses années les hommes n’ont pas été indifférents à leurs présences, et les ont qualifiées selon les endroits, de cavités, de pierres à godets, de Wasserstein etc…Il est intéressant de souligner que les appellations des pierres et des lieux où elles sont situées ont fréquemment des appellations telles que » Roche du Diable », » Roche des Fées », « pierre à sacrifice », « pierre de justice », « pierre druidique » etc…
D’après M.Gable, une partie des pierres étudiées seraient d’origine naturelle (érosion), mais une grande partie des cavités creusées dans le granite ou le grès ont été façonnées par la main humaine qui leur a donné des formes circulaires très précises ; il évoque alors une « origine anthropique »

La plupart seraient très anciennes…
- Gable a cité des recherches menées avant lui par des auteurs comme le français Roger MATHIEU, qui soutient que les pierres à cupules avaient des fonctions particulières et étaient liées à des connaissances pouvant être interprétées comme scientifiques pour leur époque.
Selon les lieux géographiques dans le monde, les pierres n’auraient pas les mêmes fonctions, mais sur le territoire national jusqu’au Portugal elles reprennent presque toutes les mêmes fonctions astronomiques, l’étendue géographique exacte reste à définir.
En y adjoignant un disque muni en son centre d’un gnomon (baguette verticale utilisée en astronomie), les pierres auraient servi de système de visée, afin de connaitre les dates importantes de l’année (horloge solaire ou calendrier permettant de déterminer les saisons en repérant équinoxes et solstices ), mais aussi pour observer les astres (soleil, lune, ou étoiles). Il a fait de nombreuses mesures sur les circonférences de ces cupules, livrant une série de diamètres avec des constantes correspondant à une unité primaire (le yard ou le pied mégalithique) et ses sous-multiples.
Le conférencier fait remarquer que l’observation des astres par les hommes est très ancienne, et suppose que la technique mise au point par nos ancêtres au travers des pierres à cupules et mégalithes aurait pu être importée d’orient au travers des routes migratoires, depuis les temps anciens.
La fourchette chronologique possible est très large, allant du Néolithique à la Protohistoire et peut-être même au delà; malheureusement aucun indice ne lui permet de mettre ces cupules en lien avec des périodes précises.

En conclusion, M. GABLE soutient l’hypothèse que les sites où sont concentrées pierres à cupules, à bassins, et autres mégalithes, étaient des instruments servant à prévoir non seulement les dates des des grands moments astronomiques , mais aussi des lieux de cérémonies liées à des cultes de type solaire ou lunaire….
A ce titre, on peut supposer qu’il existait des temples de plein air y compris dans le massif vosgien.
Résumé de la conférence du mardi 19 mars 2024: « La construction en pierres dans les châteaux forts alsaciens », par M. Jean Michel RUDRAUF
15 avril 2024Conférence de M. Jean Michel RUDRAUF
La salle du palais de la Régence, mise à disposition de la Société d’Histoire par la municipalité d’Ensisheim, a accueilli mardi 19 mars M. Jean Michel RUDRAUF pour une conférence dont le thème était « La construction en pierre dans les châteaux forts alsaciens ».
Cette conférence faisait suite à l’assemblée générale de la Société d’Histoire d’Ensisheim.

M. Jean Marie RUDRAUF
Ancien professeur de biologie désormais en retraite, M. Rudrauf est passionné d’archéologie médiévale depuis son enfance.
Il est membre du Centre de Recherches Archéologiques Médiévales de Saverne (CRAMS) , et est l’auteur de nombreux articles et ouvrages sur les châteaux forts de notre région.
Le choix des emplacements de construction
Les châteaux au Moyen Âge étaient construits sur des sites préalablement choisis.
- Rudrauf a expliqué que pour certains d’entre eux, afin d’y construire un ou plusieurs bâtiments , le terrain était soigneusement préparé. On établissait les bases d’une construction ou d’une défense de type fossé, et les pierres dégagées ou extraites pouvaient être ensuite utilisées dans la construction, à la condition qu’elles soient de bonne qualité.
Il a cité plusieurs exemples de châteaux ( Rotenburg, Wasenburg) qui illustraient le travail important de terrassement au niveau des fossés.
Il a aussi évoqué certaines constructions (Warthenberg près d’Ernolsheim-les-Saverne), qui pour des raisons inconnues (manque de financement ? défense devenue inutile ?…), n’ont jamais été terminées.
Le choix des pierres
En Alsace, la plupart des châteaux et édifices moyenâgeux étaient construit en grès, mais quelquefois aussi en granite (Ortenberg), plus rarement en roches métamorphiques ou schistes (Herrenfluh, Hugstein).
Le conférencier a expliqué que le choix des matériaux était important, et que lorsque les pierres n’étaient pas de bonne qualité sur place, d’autres carrières étaient exploitées.
Ces carrières pouvaient se trouver à proximité, ce qui limitait les coûts, mais parfois étaient plus éloignées (les pierres du Taennchel qui ont servi à l’édification du Haut-Ribeaupierre à Ribeauvillé étaient situées à environ deux kilomètres du château).
Il existe plusieurs cas où l’on constate que les matériaux anciens pouvaient être récupérés et servir à l’édification des bâtiments moyenâgeux : sur le Hagelschloss (près d’Ottrott), on remarque sur certaines pierres des entailles à queue d’aronde qui attestent d’une provenance du mur païen ceinturant le Mont Sainte Odile.
Des vestiges d’époque gauloise ou protohistorique ont aussi apparemment pu servir à construire l’enceinte de Krueth-Linsenrain près de Wettolsheim ou le Hagueneck sur les hauteurs d’Eguisheim.
Mais dans certains cas, il est difficile de dater les constructions, faute d’indices.
- Rudrauf a évoqué le château du Purpurkopf (non loin du Guirbaden à Mollkirch), en cours de fouilles par M. Florent Minot : il est considéré comme un des plus vieux châteaux forts d’Alsace, daté des 9ème ou 10ème siècles. On y a trouvé en réemploi des vestiges anciens comme une ancienne meule contemporaine de l’époque gauloise.
De nombreux édifices ont ainsi été visités et étudiés par M. Rudrauf.
Certains sont bien connus du grand public, d’autres ne le sont pas, et il est impossible de tous les nommer au travers d’un simple résumé (Heidenschloss, Durrenstein, Koenigsberg, Hoheguisheim…).
Les études effectuées au sujet de la taille des pierres ont enrichi nos connaissances.
En ce qui concerne l’appareillage, le conférencier a constaté que la taille des pierres utilisées dans les constructions est réalisée avec plus ou moins de soin selon les époques et selon la destination des bâtiments.
- Rudrauf a noté que certains châteaux (Guirbaden, Herrenstein, Hagelschloss…) présentaient des constructions en arcade, parfois de portée importante. Par exemple 6m au Hagenschloss, avec d’ailleurs actuellement des signes de grande fragilité et une menace de disparition dans les prochaines années …).
Les édifices religieux (Marmoutier, Lautenbach…) sont construits avec des pierres de taille très soignées, et ne possèdent pas de pierres à bosse, à l’inverse des ouvrages défensifs.
Les tours rondes apparaissent au 13e siècle sur plusieurs châteaux (Kaysersberg, Haut Andlau, Pflixbourg…). Au Wasigenstein, les pierres présentent alors de grosses protubérances.


Les pierres à bosse
- Rudrauf constate que les premières constructions en pierres à bosse apparaissent vers 1140 (Spesbourg, Wasenbourg…), et la question de leur utilité a souvent été posée (liée aux coûts ? à la défense ? à la résistance aux béliers ?…). Des usages farfelus sont aussi avancés parfois, comme leur avantage pour grimper aux murs, mais aussi leur contraire (empêcher l’escalade…).
La réponse tient sans doute à un souci d’économie de temps et moyens de construction des bâtiments, en ne taillant que les joints et conservant la face brute. L’effet ainsi obtenu donne aussi une impression de robustesse à l’édifice.
Cette impression de puissance est devenue une « mode » pendant des siècles.
- Rudrauf a constaté que les pierres à bosse n’étaient pas travaillées de la même façon sur les différents sites étudiés.Leurs dimensions sont variables, de l’ordre de 35cm de hauteur sur 60cm de largeur, et parfois être beaucoup plus importantes (45cm x 120cm), et un poids évalué à 1,5 tonne!
De même, leurs protubérances pouvaient atteindre 10cm, voire plus (15cm et au-delà…) selon les édifices.
Des différences dans la taille des liserés ont également été mesurées (2,5cm, 3,5cm…).
- Rudrauf constate que les pierres, à partir du 13ème siècle, sont travaillées différemment.
Certains châteaux (Hagueneck) présentent des pierres à bosse en forme de coussinet aux surfaces soigneusement taillées, réduisant d’autant la symbolique défensive du côté rupestre.
Aux16e-17éme siècles, les pierres à bossage n’ont plus qu’une fonction décorative. Pour cette période, on en trouve d’ailleurs surtout dans certaines maisons villageoises ou de petits bourgs. Peut être s’agit-il alors d’une simple réminiscence inconsciente de ces fameuses pierres à bosse.
Les marques des tailleurs
A partir de 1180, M. Rudrauf constate l’apparition de marques lapidaires sur les pierres de construction. Leur fonction n’a pas toujours été comprise ; probablement s’agissait-il de la marque spécifique d’un tailleur sur un chantier précis dans le but de faire reconnaître son travail à des fins de rémunération (mais le même ouvrier était susceptible de changer sa marque sur un autre chantier…).
- Rudrauf reconnaît que l’on ne sait pas toujours de manière précise comment ce système pouvait fonctionner. Il précise qu’à la Renaissance, les marques dites « de tâcherons» seront de façon certaine plus personnelles et tiendront lieu de signature, sans forcément de lien avec une rémunération.
Dans certaines constructions, les marques lapidaires sont des numéros d’assise qui correspondent aux rangs de pose. Leur fonction est donc de faciliter le travail des maçons. C’est le cas par exemple du logis du Haut-Barr au16e siècle où il y a 2 marques sur chaque pierre. Elles correspondent à des hauteurs en pieds (1pied, 1pied 1/4, 1pied 1/2…). Au Honack ont été repérées 14 hauteurs différentes.
Un débat a suivi la conférence et M. Rudrauf a répondu aux nombreuses questions d’un public très intéressé.
Les discussions se sont poursuivies autour d’un verre de l’amitié offert traditionnellement par la municipalité à la suite des assemblées générales.

Résumé de la conférence du mardi 27 février 2024 : « le droit local en Alsace », par M. Jean Marie WOEHRLING, président de l’institut du droit local alsacien mosellan.
13 mars 2024Stammtisch : « Le droit local en Alsace »
Jean Marie WOEHRLING
Palis de la Régence – Ensisheim
27 février 2024
La deuxième conférence de l’année 2024 s’est tenue dans la grande salle de la Régence, fraîchement rénovée et, comme à l’habitude fort appréciée, mise à disposition de la Société d’histoire par la municipalité d’Ensisheim.

M. Jean Marie WOEHRLING
- WOEHRLING, président de l’Institut du Droit Local Alsacien Mosellan, avait cordialement répondu au souhait de notre Société d’une conférence sous la forme de « Stammtisch », pour qu’un dialogue puisse se mettre en place entre lui et l’oratoire.
Face à une assistance venue nombreuse et rassemblée en « agora » autour du conférencier, M. WOEHRLING a d’abord précisé que le droit local, était un ensemble de règles de droit particulières à l’Alsace et à la Moselle, et qu’il n’était pas très différent du droit français. C’est donc un droit national, d’application propre aux deux départements alsaciens et à celui de la Moselle. Il a la même valeur juridique que toutes les autres dispositions juridiques applicables dans le reste de la France. Ce droit local était vivant et capable d’évolution.
A ce jour, ce « DL » n’est cependant pas trop présent car il ne représente qu’à peine 5 % de l’ensemble du corps de droit applicable en Alsace et Moselle. Néanmoins, la centaine de textes qui le composent encore revêtent une forte portée, tant pratique que symbolique.
- WOEHRLING a rappelé que le droit local (DL) était l’expression de l’Histoire de l’Alsace Moselle, notamment celle commencée en 1871, année de leur rattachement à l’Allemagne, un pays fédéral, ce qui a son importance. La région est constituée en « Reichsland Elsass-Lothringen», avec un pouvoir législatif propre et donc une législation spécifique à son territoire.
Pour autant, les autorités allemandes y ont maintenu l’essentiel de la législation française. Ainsi certains textes du « DL », remontent à une période antérieure à cette annexion, à l’exemple de celles mettant en œuvre le fameux Concordat de 1801, d’époque napoléonienne donc.
Vinrent ensuite celles de la période de l’Annexion, d’avant 1918, durant laquelle les lois du Reichsland s’imposaient aux territoires sous domination allemande jusqu’à la fin de la 1ère guerre mondiale ; à la même époque en France, la loi sur la séparation de l’église et de l’Etat était proclamée en 1905.
Au retour de la paix, en 1918, les autorités françaises voulaient réimposer à leur tour le droit français dans les départements anciennement annexés, avec une réintroduction progressive du droit français, dans le respect des traditions locales (voir le discours de Joffre à Thann) et avec, notamment, deux lois introductives de la législation civile et commerciale, en 1924. Pour autant, face à la vive résistance des populations des trois départements, l’unification législative a été remise à plus tard et une législation locale s’est maintenue.
En 1940,le « DL » est brièvement supprimé par les Nazis puis il sera remis en vigueur dans le cadre du rétablissement de la légalité républicaine en 1944.
L’Institut de Droit Local (IDL) Alsacien- Mosellan a été créé en 1985, pour faire suite à une prise de conscience et ainsi susciter une meilleure connaissance et une gestion modernisée de la législation locale. En effet, si le droit local concernait autrefois la plus grande partie des dispositions législatives, il est aujourd’hui attaqué et pourrait disparaître s’il n’était pas défendu de manière plus résolue et plus convaincante.
L’Alsace est en effet une région reconnue pour son paysage typique (Cathédrale, Mont-Sainte Odile, les colombages, la gastronomie,…). Mais son esprit singulier ne porte pas vraiment dans les revendications envers l’État centralisé comme peuvent le faire les Corses ou les Bretons. L’Alsacien se cherche, tergiverse, n’exprime pas une conviction claire et précise (syndrome de Hans im Schnokeloch…). Ce n’est pas gage d’un avenir porteur d’espoir. Il va falloir clarifier nos réflexions et propositions si nous voulons continuer à peser.
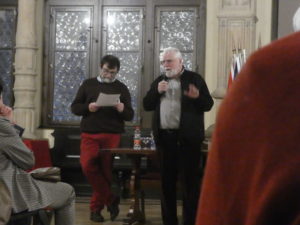
- WOERHLING est ensuite revenu sur les principaux domaines d’application du DL, en les abordant brièvement pour laisser la place au débat ensuite.
Ainsi, dans ces principaux domaines, nous retrouvons le régime particulier de l’assurance maladie, que nous apprécions particulièrement pour son taux de remboursement des soins à 90 % (mais avec des cotisations plus élevées).
Il y a également le droit local du travail (le maintien de la rémunération en cas d’absence), le repos dominical, les jours fériés supplémentaires, le préavis en cas de rupture de contrat,…)
Le cadastre et livre foncier
Le droit des cultes avec une laïcité de coopération avec l’État, respectueuse des convictions et son corollaire, l’enseignement religieux et des facultés de théologie catholiques et protestante.
Un régime propre aux associations locales (différent de la loi « française » du 1er juillet 1901).
Un droit communal, exécutoire de plein droit sans transmission préalable au représentant de l’État.
Un droit de chasse reposant sur un système de remise en location tous les neuf ans pour le compte des propriétaires fonciers, avec une gestion équilibrée des intérêts particuliers…et une droit de réparation.
Un régime local de l’artisanat.
Un régime de justice et des professions judiciaires particuliers (procédure civile, chambres commerciales, avocats, notariat, successions, partage, baux de location, assurances, faillite civile, etc…
Et enfin un droit de l’eau et un droit fluvial garantissant les usages et intégrant, déjà, des préoccupations environnementales.
Dans une deuxième partie très libre et riche en questions, M. Woehrling a de manière claire et franche, répondu aux nombreuses interrogations, très diverses, d’un public très concerné par les enjeux. Il a ainsi précisé la position de l’IDL sur les points suivants :
Question : Le droit local et la Constitution de la République ?
Le Conseil Constitutionnel a répondu en 2011, que notre droit local est constitutionnel, confirmant une position constante du Parlement en ce sens depuis 1921. Mais le Conseil ne dit rien sur le futur. Quid notamment du principe d’égalité ? Que dira-t-il s’il relève une discrimination ? Un point sensible sera notre régime d’assurance maladie.
Question : Y a-t’il des nouveautés dans le DL ?
Oui, avec l’adaptation du régime local d’assurance maladie ; le régime des cultes avec un décret relatif au financement des conseils de fabrique ; les établissements publics de 1809 ; la permission accordée aux évêques pour apporter directement des modifications au nom de la simplification et moins de centralisation ; le droit de chasse avec l’accord demandé directement aux propriétaires fonciers s’ils abandonnent le loyer de chasse aux profits des communes.
Question : L’Alsace est elle la seule région à disposer d’un droit local ?
Si l’on excepte les départements outremer oui, c’est la seule. La Corse dispose en effet d’un statut de régime particulier, c’est donc différent que pour l’Alsace, pleinement intégrée à la République. Le problème est de savoir ce que nous voulons. Quel est la région ad-hoc ? L’Alsacien n’est pas clair sur ce point, même si un récent référendum a clairement et massivement indiqué qu’il voulait un retour à une région Alsace. Comment mettre les idées en forme avec la pratique ?
Question : Un débat actuel tourne autour de l’instauration d’une commission de droit local avec une position plutôt négative du préfet quant à une participation de représentants locaux. Quelle est la position de l’IDL ?
C’est une structure qui existait déjà et qui a été supprimée. Elle a été relancée depuis 2 ans. Il y a un problème de composition puisqu’elle repose essentiellement sur des fonctionnaires ! Donc l’État. Elle est présidée par le Préfet. Il n’y a pas d’élus Alsaciens-Mosellans. Elle n’est donc pas représentative. Une commission « parallèle » vient d’être créée, avec des élus et aussi des représentants des corps professionnels et juridiques, présidée par un parlementaire alsacien, M. Reichhardt. Attendons le 29 février avec la réunion de la commission officielle, en espérant qu’elle ne se réunisse pas que tous les 29 février….
Question : Il y a la Justice européenne, toujours plus présente, la française, toujours plus importante. Pourquoi un droit local ?
Le Parlement français ne décide pas de tout. Il y a également les lois supranationales, très contraignantes. Il y a aussi ce qui relève du droit local et les considérables lois spécifiques. Il s’agit aujourd’hui de s’adapter aux situations territoriales et non pas de légiférer de manière uniforme, trop loin des considérations du terrain. C’est une demande très forte des populations !
Question : Qu’en est-il de l’enseignement du dialecte alsacien ? Le système bilingue mis en œuvre dans l’éducation nationale ne fonctionne pas. La pratique de l’alsacien régresse de manière inexorable et vertigineuse. Pourquoi ce qui a l’air de fonctionner en Corse, en Bretagne ou au Pays Basque fonctionne alors qu’ici l’échec est total ?
La CEA assure la promotion de la langue régionale mais le problème réside dans la formation des enseignants. La langue régionale, au sens de l’Education Nationale, est l’allemand. Il n’y a pas assez de professeurs d’allemand. Et rien, ou si peu, pour l’alsacien. Un ancien recteur de l’Education Nationale, M. Deillon, en avait pris conscience et l’a reconnu. Il convient de mettre en œuvre une vraie formation décentrée, avec des diplômes reconnus. C’est l’un des domaines les plus prioritaires de l’IDL et il faut agir vite et fort.
Question : L’avenir des jours fériés supplémentaires est-il remis en cause ?
Tout d’abord, la majorité des résidents en Alsace n’en connaît pas le sens. Pour la Saint-Etienne, rien à voir avec le « Bendelatag » ! C’est plus simplement le deuxième jour de Noël, donc un repos récupérateur des festivités de Noël. Pour le vendredi saint, c’est directement en rapport avec Pâques, mais avec une connotation plus religieuse. Mais il nous faut être vigilants pour ne pas voir ces jours fériés sous le seul angle du repos. Ce serait particulièrement à notre désavantage. Il faut véritablement les intégrer dans notre patrimoine culturel.
Question : Notre droit local peut-il être remis en question par Amazon ?
Le droit local n’existe que pour autant qu’il soit défendu ! Par les syndicats, l’inspection du travail. Il s’agit donc de produire un gros effort pour qu’il soit transposé, imposé en droit national.
Question : Qu’en est-il de la rémunération des ministres des cultes avec le renforcement de la pratique de l’Islam ?
En droit local, ne sont reconnus que 4 cultes statutaires : catholique, protestant luthériens, protestant réformés et juif. Ils relèvent du Concordat et sont caractérisés par une collaboration entre les pouvoirs publics et les autorités religieuses (droits et obligations). Certaines nominations font l’objet d’un droit de contrôle de l’administration (évêque par exemple) qui, en contrepartie, verse une rémunération. En échange, les communes interviennent dans l’entretien et la réparation de bâtiments cultuels. Les autres cultes peuvent se constituer en association de droit local et bénéficier, à ce titre, de la capacité juridique et de percevoir des subventions publiques, des dons ou des legs. En quelque sorte au titre de leur intérêt général. L’État ne veut pas s’engager dans autre chose !
Quelques autres questions ont encore fusé, mais l’heure avançant, il nous a fallu en arriver à la conclusion de ce premier stammtisch.

M . Woehrling a donc conclu en insistant sur le point qu’alors que nous sommes pleinement intégrés aujourd’hui à la France et à l’Europe, et que les lois s’appliquent à tous, un droit uniforme et centralisé à l’excès ne convainc plus réellement. Le droit local donne à l’inverse un sentiment d’appartenance ou d’appropriation que l’on ne ressent pas forcément avec les autres lois…Il « colle » en quelque sorte au terrain et à ses particularités.
Le droit local fait désormais partie de nos traditions et de nos spécificités et donne du corps à notre système juridique.
La population en Alsace-Moselle se dit attachée au droit local, et souhaite le conserver. Pourtant beaucoup de personnes ne savent pas toujours ce qu’il représente, et trop souvent le droit local est identifié au travers seulement du régime avantageux de remboursement de l’Assurance Maladie ou des deux jours fériés supplémentaires !
- WOEHRLING affirme à l’assemblée que le droit local a de l’avenir à la condition qu’il se modernise. Il a de nouvelles raisons d’exister, mais il importera d’être vigilant !
Un moment convivial et de nouveaux échanges a suivi la conférence autour d’une verre de l’amitié, appuyé par de succulents kugelhopfs et bretzels, dans la pure tradition alsacienne d’un stammtisch qui se respecte !
Conférence du mardi 30 janvier 2024, par M. Claude MULLER : » Splendeurs et misères du vignoble alsacien à travers le âges »
10 février 2024Splendeurs et misères du vignoble alsacien à travers les âges
Par M.Claude Muller, professeur d’histoire à l’université de Strasbourg, et grand maitre de la Confrérie St Etienne.

M. Claude MULLER
C’est à la médiathèque d’Ensisheim, mise une nouvelle fois à disposition de la SHE par la municipalité que le conférencier a été accueilli par un public venu nombreux.
En introduction, M. Muller a rappelé que l’Alsace entre l’an Mil et l’an 2000 a été française pendant 300 ans et allemande durant 700 ans, et que sa population est marquée non seulement par sa culture germanique, mais aussi par les guerres et les misères qui l’ont frappée.
Néanmoins, il y fait bon vivre, et l’un des symboles de cette qualité de vie est la vigne qui a de tout temps été cultivée dans tout le territoire alsacien et badois. On n’y distinguait d’ailleurs pas forcément le vin produit en Alsace de celui produit de l’autre coté du Rhin.
Le vin produit au Moyen Âge était le « vin des pays du Rhin ».
Les splendeurs médiévales
- Muller a évoqué l’activité liée au vin durant le Saint-Empire Romain Germanique, et les revenus qui en découlaient.
Il a cité l’exemple d’un viticulteur de Ribeauvillé (Rappoltsweiler au Moyen Âge) exportant son vin vers les pays du nord de l’Europe (Danemark, pays baltes, villes hanséatiques…)
Non seulement le vin, au départ pouvait être payé un bon prix à son producteur, mais son commerce pouvait entrainer de substantiels bénéfices pour les intervenants suivants…
Le vin assurait d’abord une activité aux tonneliers qui s’occupaient de son conditionnement, puis aux charretiers qui utilisaient leurs véhicules pour transporter les tonneaux jusqu’à Sélestat (Schlettstadt au Moyen Âge). Parvenus au port d’embarquement de la ville (le Ladhof), on faisait appel aux barques à fond plat (appelées « pinasses ») qui pouvaient circuler sur l’Ill en emportant chacune 3 tonneaux jusqu’à Strasbourg. De là, le produit était transporté sur des bateaux plus importants pouvant naviguer sur le Rhin jusqu’à leur destination finale dans le Nord de l’Europe..
Cette grande artère fluviale idéalement située dans une région fortement peuplée était d’ailleurs surnommé « Weinfluss » tant le commerce du vin y était important.
A chaque étape de son transport , de sa manipulation ou de son contrôle, le vin subissait des taxes et prélèvements divers.
Et pourtant malgré tous ces intermédiaires, le commerce du vin était très florissant. Il était considéré comme un produit de luxe ou de spéculation et pouvait générer des bénéfices de 1000 % !
Et jusqu’à 100 000hl pouvaient être vendus à Cologne sur une année, ce qui représentait 10 % d’une récolte alsacienne contemporaine !
Le déclin à compter du 16ème s.
Au début du 16ème s., il fait chaud, et le vin est bon…
A partir de 1550, les chroniques confirment que le vin devient aigre, suite à des conditions climatiques devenues défavorables. On constate effectivement un refroidissement du climat durant ces années, ce qui a des conséquences sur la qualité du vin.
En1648, l’Alsace, suite au traité de Westphalie mettant fin à la Guerre de Trente Ans, devient française, d’autres soucis apparaissent :
-Les débouchés vers le Nord se ferment
-l’Alsace se met à déguster des vins français
-Le Champagne va naitre, et va faire son apparition en Alsace
Les conséquences sont que le vin d’Alsace ne se vend plus, et les problèmes commerciaux vont s’amplifier au fil des années suivantes…
A partir de 1850,c’est le phylloxéra qui fait son apparition et ravage la France jusque dans les années 1890.
Le vignoble passe alors de 25 000 ha de vignes en 1800 à seulement 8000 ha en 1945.
C’est la catastrophe !
On cherche alors à greffer, ou à hybrider , mais le vin d’Alsace qui était autrefois servi à la table des rois n’est plus qu’un petit vin.
Il est souvent remplacé en France par le vin d’Algérie, vendu beaucoup moins cher.
Dans les années 1960-70, le vin d’Alsace n’a plus aucune considération ! (il donnait de plus « mal au crâne », sans doute à cause du souffre utilisé lors de son traitement).
« Le meilleur vin blanc au monde est le vin d’Alsace »
Les cépages hybrides sont abandonnés dans les années 1930. On replante alors des cépages alsaciens.
Après la 2ème guerre mondiale, les viticulteurs vont se mettre à l’assemblage de cépages.
On assiste à une révolution viticole dans les années 1960.
Depuis les années 1970, on recherche la qualité.
En 1975-76, le crémant, vin à bulles selon la méthode champenoise, fait son apparition. Depuis, la production de vins pour produire du crémant est en constante augmentation.
Aujourd’hui, 1/3 du vin d’Alsace est utilisé pour produire du Crémant.
A partir de 1984, le vin apparait aux desserts, et semblent apprécié par les femmes notamment.
On produit par la suite des produits plus concentrés en alcool, les vendanges tardives et autres grains nobles font leur apparition.
- Muller affirme que, grâce au renouveau qualitatif apparu entre les années 1975-1984, la réputation des vins d’alsace n’a cessé d’augmenter et leur a permis d’être aujourd’hui des vins d’exception.

Conclusion
D’après M. Muller, les vins d’Alsace sont aujourd’hui à un niveau tellement haut perché qu’il est difficile d’aller plus loin encore dans la recherche de la qualité.
Cette qualité a été fluctuante au cours des âges, et a été liée à l’histoire de l’Alsace ainsi que de son climat, qui a connu des variations.
On assiste à des changements liés à la consommation en baisse des alcools en général.
Les pouvoirs publics plaident aujourd’hui en faveur d’une sévérité plus grande face à des comportements dangereux, principalement ceux liés à la prise excessive d’alcool…

Le vignoble a été considéré au temps du Saint-Empire Romain Germanique comme un des meilleurs vignobles en Europe.
Le restera t’il encore ?
A la suite de sa conférence, M. MULLER a répondu aux nombreuses posées par un public très attentif, et un rafraichissement a été offert.
Résumé de la conférence du mardi 14 novembre 2023, par M. Jean Jacques SCHWIEN, « » En marge de l’incendie de Notre Dame, les charpentes des cathédrales en France »
20 novembre 2023CONFERENCE « En marge de l’incendie de Notre-Dame, les charpentes des cathédrales »
Par JEAN JACQUES SCHWIEN

Le conférencier, M. JEAN-JACQUES SCHWIEN
Médiathèque Espace Liberté à Ensisheim – 14 novembre 2023
Attendue ! C’est le moins que l’on puisse en dire de cette conférence tenue en un pluvieux et frisquet soir de novembre par la Société d’Histoire d’Ensisheim. Superbe, enrichissante, instructive, complète, passionnante….tels étaient les superlatifs conclusifs venant d’une majorité des 80 personnes venues y assister et encourageant ainsi nos efforts à persévérer dans la tenue de ces cycles annuels de conférences animant maintenant depuis plus d’une dizaine d’années le programme culturel de notre cité des Habsbourg.
Alors, que s’est-il donc passé entre ces deux moments ?
Le président de la SHE, Jean Jacques SCHIWIEN, par ailleurs conférencier du soir, savait à quel point sa présentation était attendue. En effet, elle avait été conçue voici près de trois ans et demi, juste après l’incendie dévastateur de la cathédrale Notre Dame de Paris, survenu le 15 avril 2019. La stupeur, succédant à la destruction totale de la charpente de l’édifice parisien, cher au coeur de toute une nation, avait sidéré les esprits et tous nous nous posions la question de l’avenir de la cathédrale et de comment parvenir à restaurer un tel joyau, et surtout la forêt de bois légendaire constituant son toit. Jean Jacques Schwien s’était alors proposé de nous informer sur l’histoire de ces charpentes vertigineuses et emblématiques, traversant l’Histoire au gré des vicissitudes guerrières, météorologiques ou accidentelles.
Tout était prêt fin 2019, lorsque le Covid et ses contraintes sanitaires nous conduisirent à reporter, à plusieurs reprises, la tenue de cette conférence. Jusqu’à ce soir de novembre 2023, où nous allions enfin être éclairés sur tous les points qui nous taraudaient.
Jean Jacques Schwien a donc accueilli le nombreux public rassemblé à la médiathèque en ouvrant une conférence riche en documents et précisions, tant techniques qu’historiques, le tout soutenu par de nombreuses vues d’édifices et de tableaux descriptifs.

Une première partie était consacrée à un point crucial : La destruction d’une charpente quasi millénaire et le besoin de reconstruction.
En premier lieu, la datation dendrochronologique de la charpente de Notre Dame et sa première construction. Fort heureusement, juste avant le désastre, une étude venait d’être conduite par des spécialistes, MM Lambert et Hoffsummer, permettant ainsi de sceller en quelque sorte la traçabilité des bois de cette charpente.
En l’occurrence, un premier état de celle-ci a pu être daté aux alentours des années 1220 / 1240, avec notamment, quelques remplois de bois de 1050. Devait suivre une significative évolution en 1859, sous la conduite de l’architecte Eugène Viollet-le-Duc, avec des travaux sur le transept et bien sûr l’historique et remarquable flèche.
Cette première approche cernée, pouvions nous établir un lien de causalité entre les travaux de restauration débutés quelques mois avant le drame et le déclenchement de l’incendie d’avril 2019 ? Bien évidemment, le temps de l’information et le temps des investigations nécessaires à l’enquête en cours étant fondamentalement différents, il n’est pas possible, aujourd’hui, de pouvoir déjà répondre avec certitude à cette question.
Néanmoins un constat peut être posé : une grande partie du « trésor de Notre-Dame » a pu être sauvé par l’action résolue et efficace des secours. Ainsi, parmi tant d’autres, les calices, la mythique couronne d’épines ou la tunique de Saint-Louis ont pu être sauvés et mis à l’abri en attendant de retrouver leur écrin. De même, l’immense inquiétude quant à l’intégrité des superbes vitraux de Notre-Dame s’est effacée, grâce encore à l’intervention des pompiers, et tous ont été préservés. Les autres craintes visant les maçonneries ou le grand orgue du 18ème ont également laissé place à la certitude de leur préservation. Jean Jacques Schwien a insisté sur l’importance des voûtes de la cathédrale qui ont pleinement joué leur rôle de protection et de pare-feu, malgré le cataclysme, contribuant significativement à épargner l’essentiel des structures de l’édifice, et limitant les dégâts, certes majeurs, à d’importants dégâts d’eaux et aux conséquences très néfastes de la fonte massive des plomb de la toiture, entraînant de sérieux désordres de maçonnerie.
L’intérêt massif des parisiens et de la population en général a rapidement rassuré les « rebatisseurs » sur l’aspect financier de la reconstruction. Les mécènes…et les polémiques… sont parvenus à réunir une somme significative qui devrait permettre d’accompagner les travaux nécessaires. De surcroît, une volonté politique affichée, et surtout la mobilisation de l’ensemble des corps de métiers et des confréries, ont permis d’engager rapidement la reconstruction, qu’une décision présidentielle, après consultation populaire quant à une forme historique ou contemporaine, a fixé comme devant être à l’identique, flèche de Viollet-le-Duc comprise.
Le monde scientifique s’est également penché sur le sort de Notre-Dame, rassemblant plusieurs dizaines d’experts et les premiers effets de la reconstruction sont d’ores et déjà visibles depuis mars 2023.

Dans une seconde partie, Jean Jacques Schwien a abordé l’épineuse question des incendies, sommes toutes fréquents, des édifices religieux au cours des siècles, affectant plus particulièrement les cathédrales.
L’emblématique incendie de la cathédrale de Strasbourg, gravement touchée par les artilleurs allemands en 1870, intègre en effet une longue série de sinistres similaires tels qu’à Vezelay en 1165, Canterbury en 1174, Notre-Dame de Paris (déjà) en 1218, Amiens en 1528, Troyes en 1700, Reims en 1914 ou, plus près de nous, Toul en 1940 et Nantes en 1972, parmi tant d’autres.
Très peu de monographies existent sur ces incendies, permettant de mieux comprendre leurs causes, à l’exception de celui de la cathédrale de Reims en septembre 1914, très gravement endommagée à la suite d’un méthodique travail d’artillerie qui pourrait aussi avoir été appuyé par une logique politique, l’édifice présentant, aux yeux des français, une signification historique particulièrement prégnante.
Certains de ces incendies pouvaient détruire, notamment sous le Moyen-Âge, des quartiers entiers. On dénombre ainsi pas moins d’une soixantaine de sinistres majeurs entre les 10e et 15e siècles, surtout dans la seconde partie de la période considérée. Un tableau fort précis est commenté par le conférencier et attribue l’origine fréquente des causes de 20 incendies majeurs examinés, au déclenchement de la foudre (13 fois), mais aussi à des travaux en cours (comme vraisemblablement à l’incendie récent de Notre-Dame) ou à des faits de guerre comme nous venons de le voir en 1870, 1914 ou encore en 1944.
D’efficaces mesures avaient été prises au Moyen-Âge en guise de parades à l’extension cataclysmique de ces incendies, survenant souvent au coeur des villes, afin de limiter la propagation aux maisons voisines, créant de véritables espaces pare-feu comme on peut le voir dans les actuels incendies de forêts, et n’hésitant pas en cas de besoin, à détruire les maisons mêmes saines lorsqu’elles étaient contiguës au brasier.
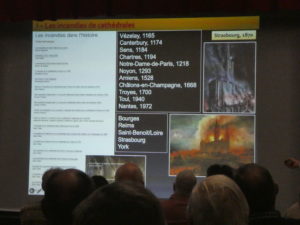
Enfin, dans une troisième partie, Jean Jacques Schwien a exposé à l’assemblée les différentes conceptions de toitures de cathédrales et leurs évolutions.
Très majoritairement élaborées à l’aide de bois d’oeuvre, certaines de ces charpentes sont conçues à partir d’éléments métalliques, comme à Reims, Metz ou Noyon.
La documentation médiévale dispose certes d’images et de représentations en nombre des chantiers de construction , mais l’essentiel concerne la taille de pierre, le gâchage du mortier ou le transport des matériaux et très peu sur la conception des charpentes, ou alors elles ne sont guère réalistes. On peut néanmoins dégager quelques axes forts sur ce thème.
Les types de couvertures : elles sont très fréquemment en plomb (par exemple à Paris ou Strasbourg médiéval) ; en cuivre dans le cas de Strasbourg depuis 1765 ; en tuiles (à Auxerre) ou plus rarement en ardoise.
Les charpentes proprement dites donnent l’impression d’une forêt de bois. Beaucoup sont conçues en forme de coque de bateau renversée.
Les bois d’oeuvre viennent souvent des forêts proches du site dans un rayon de 50 kilomètres. Par exemple pour Strasbourg, ils viennent majoritairement de Forêt-Noire. Le transport des poutres et planches se faisait au moyen de radeau de bois, par les rivières et canaux. La masse d’arbres nécessaires, venant quelquefois à se raréfier, a très vite interpellé les charpentiers d’où une gestion drastique du bois d’oeuvre par les seigneurs et autres institutions, mettant en oeuvre une véritable économie du bois en quelque sorte.
Les étapes de la construction proprement dite des charpentes nous est encore assez opaque, en raison de l’absence de plans permettant de visualiser la masse des bois nécessaires, et leur imbrication. Les appellations sont certes définies, les pièces pouvant être des fermes, des entraits, des pannes, des contreventements, etc.… Le travail avant pose sur l’édifice était réalisé sur place et en amont, avec une épure au sol (sur un plancher) des charpentiers, une numérotation en chiffres romains ou signes cabalistiques, puis un démontage avant mise en place.
La phase du remontage proprement dite est donc, quant à elle, plus vague. Des échelles, très grandes, des échafaudages et des treuils à roues servaient à hisser hommes et matériel jusqu’au dessus des voûtes pour y assembler les éléments de charpentes, dans des conditions qu’on peut imaginer aisément comme risquées. Plusieurs de ces treuils à roues sont conservés en Alsace ou alentours (Colmar, Strasbourg, Thann, Fribourg). Le montage de fermes complètes par le biais de ces treuils n’est pas impossible.
Le conférencier a ensuite présenté les différents types de charpentes, regroupées en deux périodes principales. Un premier type, avec des fermes de 30° de pente, couvrent une large période de l’époque romaine à la période romane. Les exemples conservés sont rares: on peut citer un édifice en Egypte, daté du 6ème siècle après Jésus-Christ. Pour Saint-Pierre de Rome, une fresque visualise sa charpente du 4ème siècle, détruite au 17e s. Pour l’époque romane, elles sont plus fréquentes, avec des exemples cités de Rosheim, Haguenau ou (les maisons urbaines de) Cluny.
A partir de 1200/1250 environ, leur format change du tout au tout, avec en particulier des toits très pentus, de 60° d’ouverture en moyenne. Des recherches régionales systématiques ont été menées au moyen de datations dendrochronologiques sur la Normandie et le nord de la France, pointant des dizaines d’exemples (cathédrales et abbayes cofondues). L’Alsace n’est pas en reste, avec les cas bien détaillés par le conférencier de Saint-Thiébaut à Thann (1418-1475) tout comme ceux de bâtiments civils tels le grenier à sel de Wissembourg (1448) ou une maison particulière à Dambach-la-Ville (1439). On se demande pourquoi une telle évolution, qui fragilise les toitures, sous l’effet de la poussée des vents. On peut avancer, mais sans certitude, la nécessité technique de toitures dépassant les hautes voûtes gothiques tout comme le besoin d’équilibre esthétique entre ces édifices élancés et leur couvrement (un rapport de deux tiers/un tiers dans le cas de Thann).

Cet élancement, en tout cas a aussi entraîné des modifications des modules de couverture, en particulier des tuiles. En effet, les charpentes romaines étaient couvertes de tuiles plates sans moyens de fixation. On n’a gère d’informations sur les charpentes romanes encore existantes, bien évidemment largement remplacées depuis leur mise en place. En revanche, les édifices gothiques avec leur pentes de toitures raides n’ont pu couvertes qu’avec des tuiles à crochet, « suspendues » au lattis. Le détail des étapes de cette évolution nous échappe encore mais la tendance générale est assurée. De ce point de vue, on peut dire que les édifices gothiques n’auraient pas pu être conçus sans cette micro-révolution de la tuile à crochet, tout comme ils n’auraient pas pu voir le jour sans le développement de la métallurgie du fer qui assure partout un complément indispensable au montage des maçonneries (un sujet qui pourrait faire l’objet d’un autre exposé…).
Au total, on note que le charpentier devient un partenaire majeur de la construction des grands édifices à l’époque gothique. Il participe même de la révolution du gothique tout comme le forgeron. Pour ce dernier, on le soupçonnait depuis quelques décennies. Mais grâce aux datations dendrochronologiques qui permettent désormais de mettre en relation des charpentes élaborées au même moment que les maçonneries avec arc-boutants et voûtes d’ogives, on peut ajouter les spécialistes du bois à la liste des artisans-ingénieurs du XIIIe siècle. Il est clair aussi qu’ils ont été nombreux à oeuvrer à ces évolutions, du fait de différences régionales très fortes d’une charpente à l’autre. Et leurs noms nous sont presque tous inconnus avant la seconde moitié du XVe siècle, tout comme ceux des architectes. Ce qui a donc disparu avec l’incendie de Notre-Dame de Paris, c’est un joyau en bois tout autant important que les sculptures ou vitraux, ici heureusement préservés.
Conférence du 15 novembre 2022: « Ensisheim-Réguisheimerfeld, six millénaires d’occupation », par Muriel ROTH ZEHNER responsable d’opérations Archéologie d’Alsace, Fanny CHENAL archéo anthropologue INRAP, Sylvain GRISELIN paléolithicien L
24 avril 2023Conférence du 15 novembre 2022:
« Ensisheim-Réguisheimerfeld, six millénaires d’occupation »
Par:
Muriel Roth-Zehner, responsable d’opérations, Archéologie Alsace
Fanny Chenal, archéo-anthropologue, INRAP
Sylvain Griselin, paléolithicien, INRAP


Cette conférence, prévue depuis longtemps, avait dû être reportée à cause de la crise sanitaire.
Elle s’est déroulée dans la salle de la médiathèque d’Ensisheim, mise à disposition de la Société d’Histoire par la municipalité, en présence d’un public venu très nombreux.
Les trois intervenants ont travaillé de 2017 à 2020 dans le cadre de fouilles préventives menées sur le site de la ZAID.
D’une surface de 44 hectares, elle représente la plus grande zone fouillée à ce jour en Alsace, et a permis la mise au jour de nombreux vestiges de différentes époques, du mésolithique
(-8500 ans) pour la plus ancienne, à l’époque mérovingienne (+600 ans), pour la plus récente. Il y aussi des vestiges de la guerre de Trente ans, mais qui, faute de temps, n’ont pu être évoqués au cours de la conférence.
La méthodologie
Au départ de la fouille, un archéologue guide la pelle mécanique qui décape minutieusement le terrain par tranche de quelques centimètres, pour découvrir et conserver in situ les traces d’occupation et surtout du mobilier (les objets); l’équipe peut ainsi délimiter les concentrations d’occupation.
A tour de rôle, et s’appuyant sur de nombreuses photographies, les trois conférenciers ont fait part à un public attentif du bilan de ces fouilles. Ils ont expliqué quelles étaient les techniques utilisées pour dater, répertorier , étudier les éléments recueillis. Des vérifications et études sont aussi menées en laboratoire, en complément des constatations faites sur le terrain, comme par exemple l’anthropologie ou l’étude des squelettes.
Sur le site fouillé ont été identifiées des traces d’occupation humaines de périodes très différentes. Nous en résumons ici les principales.


Du Mésolithique au Néolithique (8000/5000 av. Jésus-Christ.):
la fin d’une ère glacière et les débuts de l’agriculture
Selon Mr Griselin, après plusieurs épisodes très froids à l’échelle de l’Europe, le climat se réchauffe progressivement, aboutissant à la période tempérée que nous connaissons encore aujourd’hui. Les glaciers qui recouvraient le nord du continent fondent, le niveau des océans monte, entrainant la formation de la Manche et transformant la Grande Bretagne en une île.
A divers endroits de la planète, les groupes humains ont sans doute subi de grands bouleversements: à l’occasion de la journée « portes ouvertes » sur le site de fouilles en 2018, un archéologue nous avait d’ailleurs expliqué que les changements climatiques accompagnés d’inondations étaient peut-être à l’origine des grands mythes tel le déluge…
Sur le site de la ZAID, des phénomènes torrentiels ont vraisemblablement provoqué des dépôts limoneux et argileux, qui, par la suite ont été entaillés par l’Ill, qui à ce moment-là n’était pas encore pas stabilisée. Non loin de ses berges se sont installées des populations, dont les traces ont été figées lors de ces débordements qui les ont recouvertes de sédiments, et qu’il est possible d’identifier aujourd’hui au travers des fouilles.
Sur environ 4500 ans, la forêt se referme sur le paysage et la faune a change avec l’apparition de grands herbivores (aurochs, cerfs…) et les animaux classiques. L’utilisation de l’arc se généralise pour les chasseurs. Cette période était jusque là assez rarement observée en Alsace (un site à Erstein en 1914 avec une tombe et la grotte d’Oberlarg dans le Sundgau, fouillée dans les années 1970).
On constate 5 périodes d’occupation
– 8 500/8000 : nombreux silex en forme de flèches, provenant du Jura et des Vosges
– 7 500/7 000 : les territoires de provenance des silex changent, venant du Jura sud ou de la Forêt Noire. Les tailles sont plus précises.
– 6 500/6000 : les silex reviennent à nouveau du Piémont des Vosges, de la Forêt Noire, du Jura. On trouve des foyers, des occupations peu denses, pas mal d’ossements animaliers, la chasse semble extérieure à la zone. Il y a aussi des sépultures, dont le plus ancien habitant d’Ensisheim (6 300/ 6000).
– 6 000/5600 : les traces sont plus dispersées.
– 5 200 / 4800 : les silex sont très travaillés. Les découvertes sont reliées en deux concentrations, traduisant l’existence d’un campement plutôt important. On est proche du Néolithique. Des relations avec l’Allemagne et l’Autriche via le Neckar et le Rhin sont supposées de par la nature des objets mobilier.
Du Néolithique à l’âge du Bronze (-5000 à -2200)
D’autres périodes d’occupation se succèdent, d’abord encore avec des traces d’outils (mésolithique tardif, -5000 ans, le « rubané ancien », « rubané récent ») puis les premières nécropoles (« période du Grossgartach », « culture de Roessen » etc..). De nouveaux artefacts sont identifiés, notamment les poteries, qui aident à la compréhension du mode de vie des populations de l’époque, mais certains objets restent énigmatiques, leur signification ou leurs usages ne pouvant être expliqués.
Les sépultures (soit, selon les époques, des tombes à incinération ou des inhumations ) sont méticuleusement étudiées.
Une partie de la conférence a été consacrée à montrer comment ces vestiges étaient fouillés, analysés, datés.
Mme Chenal explique les différentes méthodes permettant l’identification des ossements et squelettes découverts, selon qu’ils soient déposés en pleine terre ou non (modifications importantes de la préservation), selon leurs positions (foetales ou sur le dos), l’études des bassins (homme ou femme) ou des dentitions (jeunes ou adultes).
La conférencières détaille un peu les corps découverts par ailleurs, sur d’autres sites généralement alsaciens, puis revient à ceux découverts à Ensisheim dans les différentes nécropoles.
Elle précise les différents types de mobiliers funéraires découverts (coquillages, herminettes, ossements, bracelets, fibules etc…).
Il semblerait que les inhumations, selon les périodes, soient généralement orientées NE/SO ou O/E.
Puis les modes changent avec l’apparition probable des premiers cercueils, des troncs évidés.


De l’Age du Bronze à l’âge du Fer puis à l’époque romaine (-2500 / +500)
Selon Mme Zehner, les fouilles du XIXe siècle avaient déjà livré un tumulus princier de cette période (les objets mobilier sont exposés au musée Unterlinden à Colmar). Ici, l’étude systématique des restes de tumuli de l’âge du Bronze (-2500/-800) ont permis de compléter ces observations anciennes mettant en évidence de nombreux rites funéraires différents (présence d’un ou de plusieurs individus, dépôt d’offrandes, d’objets de type céramiques, bijoux ou armes…).
Les deux périodes de l’Age du Fer (Hallstatt puis Tène, appelée aussi époque gauloise, soit -800 / -50) sont bien représentées avec notamment des monuments funéraires carrés contenant une crémation en leur centre.
Pour l’époque romaine , on ne trouve pas ici de grandes et riches villas; la population était rurale et disposait de moyens sans doute modestes. Des bâtiments d’habitation ainsi que des greniers y ont été identifiés. Cette population de l’époque romaine parait aussi s’être organisée autour d’une mare, vestige d’un ancien cours d’eau.
Mme Zehner détaille ensuite l’organisation des nécropoles.
51 monuments funéraires ont été mis au jour, totalisant un peu plus de 170 sépultures (inhumations et crémations). C’est le plus grand site en Alsace jamais fouillé !
Elle explique le rite des funérailles qui se déroulait en 2 temps :
– On parait d’abord le cadavre avant de l’amener sur le bûcher, suivi vraisemblablement par un banquet ;
– Puis, quelque temps plus tard (des semaines voire une année), le corps était mis en terre. Etait-il alors regroupé avec d’autres corps ? Là on rajoutait des offrandes, et c’est ce qui est retrouvé par les archéologues.
A Ensisheim, certaines tombes sont entourées de palissades. On retrouve plusieurs nécropoles:
– Pour les années -1325/-1100, les tombes sont rectangulaires, plutôt riches en offrandes (bracelets torsadés, épingles) ;
– De -1100 à -950, les premiers morts sont enterrés dans des tombes quadrangulaires, avec des vases de stockage, du mobilier métallique. Certains monuments sont uniques en Alsace avec des céramiques, un service à 29 vases, des parures en verre, des perles et même des petites parures en or (1mm). On retrouve des vases ossuaires.
– De -950 à -800, il y a grands monuments dont un à plusieurs tombes.
– De -850 à -660, les tombes sont en très mauvais état. Mais elles ont aussi livré une très belle boucle de ceinture en cuir.
– De -660 à -600, une tombe (la 205) comprend des bracelets typiques du bassin rhénan, mais mal conservée et peu de restes.
Mme Zehner précise encore l’habitat mis en évidence à proximité de ces nécropoles, avec notamment des points de passage matérialisant vraisemblablement leurs points d’accès.
Il y a 69 bâtiments découverts à ce jour.
– Des bâtiments posés sur poteaux, jusqu’à 30 mètres de longueur, ainsi que des petits greniers aériens reposant sur une base de 4, 6 ou 9 poteaux.
– Des bâtiments absidiaux, datés de la fin de l’âge du Bronze et début l’âge du Fer. C’est tout à fait exceptionnel en Alsace.
– Une centaine de silos enterrés, servant à stocker les semences.
Enfin, Mme Zehner évoque la découverte de quelques objets mystérieux tels que des croissants d’argile ou d’autres à la forme de tuiles faîtières dont la destination reste inconnue.
Conclusion
Au final, sur ce site, les scientifiques ont pu identifier pas moins de 25 phases différentes, avec chacune ses modes de vie, ses rites funéraires…
Pour chacune des périodes déterminées, A chaque fois, les chercheurs se sont efforcés de répondre aux questions suivantes:
– qui étaient nos ancêtres ,
– quelles étaient leurs caractéristiques morphologiques
– leur espérance de vie
– leur patrimoine génétique
– étaient-ils malades
– comment subissaient-ils les périodes de crise
– de quoi se nourrissaient-ils ?
– quelles pouvaient être les causes de leur décès?
Les fouilles ne sont pas terminées et une nouvelle tranche vient de débuter. Bref, il y aura de quoi tenir probablement une seconde conférence.
A la fin de la conférence, le public averti et passionné a posé de très nombreuses questions; les trois intervenants ont à chaque fois satisfait sa curiosité.
Comme de coutume, la soirée s’est terminée autour d’un rafraichissement offert par la Société d’Histoire.
Résumé de la conférence du 11 avril 2023 par M. Bernard BOHLY, archéologue : « Les mines de WEGSCHEID (vallée de MASEVAUX) à la fin du Moyen Age, 35 ans d’investigations ».
24 avril 2023« Les mines de Wegscheid à la fin du Moyen-Âge,35 ans d’investigations »
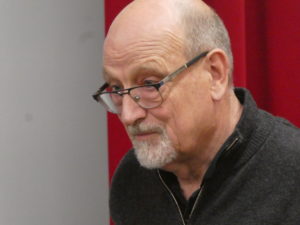
Bernard BOHLY – Archéologue

Faisant suite à l’assemblée générale 2023 de la Société d’Histoire d’Ensisheim, le 11 avril 2023 en la médiathèque « Espace Liberté » d’Ensisheim, conduite de main de maître par son président Jean-Jacques SCHWIEN, le public plutôt nombreux a assisté à une conférence originale et captivante menée par M. Bernard BOHLY, archéologue, sur le thème des mines exploitées durant le Moyen-Âge dans le secteur de Wegscheid (vallée de Masevaux). 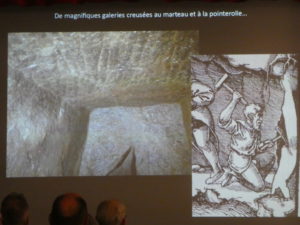
L’assemblée était donc invitée à plonger dans une époque lointaine, quelque part entre les 14ème et 16ème siècles, dans les dédales d’un petit espace minier creusé par les hommes de cette ère, en fond du vallon de Soultzbach, un affluent de la Doller. Forts des travaux conduits par son équipe depuis le milieu des années 1980, Bernard BOHLY, intarissable sur son sujet, a tenu en haleine l’auditoire par son récit, ses photographies, ses croquis et quelques anecdotes captivantes.
Introduit par une première approche géologique permettant d’identifier le type du gisement minier et les minerais recherchés, à savoir des sulfures de plomb, de cuivre, de zinc ainsi que des cuivres argentifères, le public a été informé des aspects historiques de l’existence de ces mines un peu atypiques.
La première mention se retrouve dans une charte historique de 1387, passée entre l’archiduc d’Autriche et l’Abbaye de Masevaux. Chaque partie se réservant, en résumé, la moitié des subsides.
Au 15ème siècle, sous l’impulsion de sociétés d’investissement de Bâle et de Strasbourg, plusieurs mines sont creusées et, un peu en avance sur les sociétés actuelles, une économie de capitaux est créée, avec un regroupement de 38 actionnaires se partageant les parts sociales.
C’est à cette période, relativement brève, que se situe l’apogée de l’exploitation minière dans ce petit vallon. En effet, dès 1527, on relève une première baisse de production, à tel point que l’archiduc d’Autriche envoie une équipe d’inspection pour évaluer les difficultés. Le travail mené est plutôt intéressant à étudier aujourd’hui, car il a permis de dresser un inventaire des mines exploitées, ainsi que de l’ensemble des installations du vallon. Travail précieux pour les historiens que nous prétendons être !
C’est ainsi que des matériels originaux pour l’époque ont été identifiés, tels qu’un système de pompage par filtration (une pompe à balles), de 1555.
Une légère reprise de l’activité a suivi cette mission d’inspection, hélas guère pérenne, puisque dès la fin du 16ème siècle, la production a de nouveau chuté. Définitivement cette fois, entraînant l’abandon en l’état des installations.
Une personnalité bien connue du monde des mineurs de potasse, Joseph Vogt, a tenté 3 siècles plus tard, en 1908, de relancer l’activité en réinvestissant dans le fond du vallon de Soultzbach. Mais là encore, c’était peine perdue car, après 3 années d’efforts, il a fallu se rendre à l’évidence et abandonner tout espoir. C’est définitivement que les installations ont été démontées et le paysage rendu à son décor originel. Néanmoins, les études et les travaux de Joseph Vogt se sont révélés précieux pour les recherches de l’équipe de Bernard BOHLY.
C’est en effet à partir de ces relevés que les équipes se sont mises au travail, au mitan des années 1980, reprenant méthodiquement chacune des 4 mines identifiées et s’enfonçant à leur tour dans les entrailles du vallon, à la recherche des activités des mineurs du 15ème siècle.
Une des particularités des mines de Wegscheid réside dans leur implantation, perpendiculaire à l’axe du vallon. Entre 1987 et aujourd’hui, ce sont ainsi quatre mines qui ont été méthodiquement dégagées et examinées par Bernard BOHLY et ses amis.
La première d’entre elle, celle de Saint Wolfgang, a été explorée à partir de 1987. Elle présente la particularité d’avoir ses galeries creusées au feu. C’est une technique utilisée par les mineurs de l’époque, qui ne disposaient pas des outils performants de nos jours. Le mineur accumulait des matière combustibles, en général du bois, et y mettait le feu. Ce dernier brûlait un certain temps puis le mineur intervenait sur la roche pour en dégager des petites plaques de minerai. Le travail était long, fastidieux et guère enrichissant. Une expérimentation contemporaine menée dans les Alpes par l’équipe de Bruno ANCEL a permis de juger de l’ampleur du travail nécessaire pour gagner quelques centimètres.
Patiemment dégagé, un plan complet de cette petite mine, avec ses galeries et puits, a pu être établi. Les chercheurs y ont trouvé quelques céramiques culinaires au fond, attestant que les mineurs y prenaient leurs repas sur place, ainsi que des fragments de lampe en terre cuite datée de la fin du 15ème siècle.


Une seconde mine, celle de Fürstenbau, a été explorée à compter de 2016.
Les chercheurs ont pu déterminer que l’activité y avait cessé en 1527. Elle était creusée et exploitée selon la méthode du mineur unique. C’est à dire qu’un seul mineur y travaillait, creusant et exploitant selon une formule au forfait. La première partie de cette mine a également été taillée au feu. En revanche la seconde partie était taillée avec une technique un peu plus connue, à la pointerolle. Là encore, le travail était pénible et ne progressait qu’avec parcimonie, en l’occurrence 2,25 mètres en 14 semaines.
La troisième mine a avoir été fouillée est celle d’Unserfrau. Les recherches y ont débuté en 1995. Ce site s’est révélé particulièrement complexe à explorer, entraînant de nombreuses déconvenues et complications, tant pour l’équipe de M. BOHLY que pour les habitations riveraines. Néanmoins les découvertes y furent surprenantes.
Ainsi, alors que l’équipe était au travail de l’autre coté de la petite route serpentant au fond du vallon, un riverain la sollicitait afin de venir examiner le sous-sol du jardin de sa maison, qui présentait des signes récurrents d’effondrement. Le riverain lui-même, alors qu’il vaquait à son activité de jardinage avait été brutalement emporté 4 mètres plus bas, dans une excavation soudainement ouverte par un effondrement. Malgré plusieurs comblements, la terre continuait à se dérober au fil du temps. Des premières recherches menées par M. BOHLY confirmaient qu’à l’aplomb des effondrements se trouvait bien un puits. Probablement en lien avec l’entrée de la mine Unserfrau située de l’autre coté de la route. De fouilles en fouilles, la gravité de la situation n’en devenait que plus évidente. Car sous la terre, les chercheurs découvraient quelques années plus tard, un cuvelage médiéval en parfait état,…car immergé. Il était constitué de poutres de sapin, empilées sur 9 épaisseurs, sous forme d’un quadrilatère, l’ensemble reposant sur 2 poutres principales, toujours en sapin, de section d’environ 20 centimètres. Le tout s’appuyant sur une espèce de voûte en pierre menaçant de s’écrouler sous l’action du ravinage. En résumé, la situation devenait périlleuse, tant pour les chercheurs, que pour le riverain, voire pour l’ensemble du site. La mairie s’étant portée acquéreuse d’une partie du terrain, des travaux d’ampleur ont été mis en œuvre sous la conduite de la DREAL, consistant à couler une grosse chape de béton avant de remblayer. La situation reste à l’avenir sous surveillance et, compte-tenu d’une ambiance un peu conflictuelle, M. BOHLY et ses amis en sont quittes pour poursuivre leurs recherches dans les autres mines du vallon.
La quatrième et dernière mine est celle du Reichenberg. Son exploration a débuté en 1998 et elle est toujours en cours.
L’entrée de cette mine a été effectuée au dépilage, rendant compliqué son accès tout en dévers. Les chercheurs ont progressé dans les boyaux, extrayant au fur et à mesure les déchets ayant quasiment comblé la totalité du site. Ils y ont mis en évidence le creusement d’un caniveau servant à évacuer les eaux, caniveau qui présente la particularité d’avoir été équipé de planches de bois dans son fond sur 20cm de large. Un ingénieux système de pompe a également été identifié et il a fallu mettre en place un système d’évacuation à partir de rails et de wagonnets avec des petits sceaux pour permettre la sortie des gravats. Une fois le travail d’excavation achevé, les chercheurs ont été confrontés à la difficulté d’aménager l’entrée de la mine, à l’aide de 7 buses en bétons spécialement confectionnées à cette fin. Là encore, M. BOHLY a passionné l’auditoire en narrant toutes les péripéties inhérentes à ce type d’ouvrage.
En conclusion, le conférencier est revenu sur la richesse de la découverte de mobiliers en tous genres, tels qu’un exceptionnel creuset, des outils cuivreux, des pointerolles qui, pour quasiment la totalité, étaient fabriquées directement sur place, sachant qu’il fallait près d’une dizaine de pointerolles par jour et par mineur, cela peut donner une idée du volume qu’il fallait produire. Divers autres outils ont été retrouvés dans les galeries abandonnées et comblées, tels qu’un marteau de forme octogonale, un râteau pour rassembler les gravats, une auge en orme, etc… le tout daté du 16ème siècle.
L’ensemble des explications de M. BOHLY étaient systématiquement appuyées par des diapositives, des plans ou des croquis, établis de sa propre main, rendant ainsi cette conférence particulièrement claire et ludique.
Chaleureusement applaudi par l’assemblée conquise par la passion et la compétence de son invité, M. BOHLY s’est vu remettre un petit présent par le président de la Société d’Histoire, dont les membres ont ensuite poursuivi les échanges autour du traditionnel pot d’après conférence.
Assemblée Générale de la Société d’Histoire d’Ensisheim le mardi 11 avril 2023, à 19h15 à la médiathèque-Espace Liberté. L’Assemblée Générale sera suivie à 20h15 par la conférence de M. Bernard BOHLY, archéologue
22 mars 2023Ensisheim, le 21 mars 2023
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Madame, monsieur, chers membres,
J’ai le plaisir de vous convier à l’assemblée générale de notre Société qui se tiendra
le mardi 11 avril 2023, à 19h15,
à la Médiathèque-Espace Liberté, à Ensisheim
Ordre du jour :
– Rapport du Président
– Procès-verbal de la dernière assemblée générale (voir la version en ligne sur notre page Web)
– Rapport du trésorier
– Rapport des réviseurs aux comptes
– Quitus et désignation des réviseurs aux comptes
– Cotisation 2023
– Renouvellement du comité (1/3 des membres)
– Questions diverses.
Les membres à jour de leur cotisation au 31 décembre 2022 désirant faire partie du comité sont
priés de déposer leur candidature auprès du président avant le 31 mars 2023.
Notre assemblée générale sera suivie d’une conférence, à 20h15
intitulée :
» Les mines de Wegscheid (vallée de Masevaux) à la fin du Moyen Age, 35 ans d’investigations. »
par Bernard BOHLY, archéologue
Le verre de l’amitié, offert par la municipalité, clôturera cette soirée.
Dans l’attente de vous y rencontrer, je vous fais part de mes salutations les plus cordiales.
Jean-Jacques SCHWIEN
Président de la Société d’Histoire
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Site internet: http://www.associations-ensisheim.com/association/societe-dhistoire/
Compte rendu de l’Assemblée Générale de la Société d’Histoire d’Ensisheim du 5 avril 2022
22 mars 2023ORDRE DU JOUR
Début de l’AG à 19 H 20.
Le Président Jean Jacques SCHWIEN salue Mr Jean Pierre BRUYERE représentant la municipalité
Il excuse Mr le Maire Michel HABIG retenu par ailleurs ainsi que Madame Gabrielle COADIC et Mr Jean Marie SCHREIBER ;
Gabrielle LAMMERT , secrétaire est également excusée.
Ses remerciements vont à la municipalité pour la mise à disposition de la Régence ,du moment de convivialité offert lors de chaque Assemblée Générale et pour la parution de toutes nos conférences dans le bulletin culturel .
Il demande une minute de silence pour les membres décédés au cours de l’année
– Le Procès Verbal de la dernière Assemblée générale sera mis sur le site . Il est soumis au vote et approuvé à l’unanimité.
– Le Rapport Financier par le Trésorier Mr Philippe DREXLER
Les comptes sont présentés en détails : Recettes, dépenses, intérêts, solde final.
Les réviseurs aux comptes, Mme Sonia GARDINI et Mr Paul DEYBER ont constaté l’exactitude des comptes et vérifiés toutes les pièces justificatives et demandent à l’assemblée de donner quitus au comité pour la bonne gestion. Approbation à l’unanimité.
Pour l’exercice 2022 l’assemblée renouvelle le mandat des 2 réviseurs.
– COTISATIONS 2022
Le montant de 10 € par personne est mis au vote et approuvé à l’unanimité.
Le Président invite les personnes présentes à s’acquitter de leur cotisation à l’issue de l’AG auprès du trésorier.
– ELECTION des Membres sortants :
– Mr Francis HANS
– Mr Jean Luc CLAUSSE
– Mr Martin MISSLIN
–
Tous les membres sortants sont réélus à l’unanimité pour 3 ans.
– RAPPORT d’ACTIVITES par le Président.
Les activités de la SH ont été fortement impactées par la période de la Covid et des réglementations en vigueur.
Des conférences ont été reportées celle de Nicolas STOSSKOPF sur l’industrialisation ainsi que celle sur les fouilles THK, ainsi que celle de Gérard MICHEL sur ROUFFACH .
Si des manifestations publiques n’ont pu avoir lieu la SH n’a pas été inactive pour autant. Nous avons participé à la préparation du film de l’OLCA sur la rue de la Monnaie à Ensisheim, émission à voir sur « Was hesch im Schild ? »
Monsieur Jean Marie SCHREIBER a fait don à la SH résumant 40 à 50 ans de journalisme à travers 18 000 photos.
Cette source fabuleuse de renseignement de la vie locale demande un travail de bénédictin largement entamé par Francis HANS et Jean Luc CLAUSSE .
Cette documentation sera traitée sous forme d’exposition lors des Journées du Patrimoine. Nous pourrons ainsi mettre à l’honneur ce journaliste actif, fidèle et généreux.
La SH a donné son soutien à Mme KRUST pour la présentation de son livre sur l’odyssée de sa famille. Une présentation publique a eu lieu à la Médiathèque. Intérêt tout particulier pour cette période astronautique des frères Krust dans les années 70-80. Notre contribution a été de préparer l’exposition photos. Ce travail sera de nouveau présenté le 18 juin 2022 lors de la Bourse aux Météorites.
La SH sera présente à KALISTOIRE en juin par Maurice GARDINI.
Pour les conférences à venir Mr Francis LEVY se propose d’évoquer la vie de Mr Oscar LEVY, l’Histoire de la présence juive à Ensisheim.
L’histoire des ECOLES se poursuit grâce aux recherches de Jean Luc Clausse, Martin Misslin et Francis Hans.
La SH poursuit également le travail de mémoire avec les scolaires en partenariat avec les associations patriotiques grâce à l’engagement de Francis HANS
ECHANGES et DISCUSSIONS
Des échanges intéressants continuent cette AG.
L’entretien des abords du Quatelbach , Mr Bruyère précise les responsabilités de chacun . Mr Isner propose de faire une réflexion sur le devenir des berges.
Mr Guillaume Marty propose une autre réflexion sur les prés St Jean et le canal.
Mr Bruyère fait un point sur le nouveau sentier pédagogique des Tumuli cofinancé par la Fédération des Chasseurs du Haut Rhin. Ce parcours mettra en valeur la faune et la flore des alentours. Il est également précisé que Mr Gilles Fischer s’occupe de l’opération Tumuli – meilleur entretien.
Le grand chantier de travaux de la Régence est évoqué . Restauration de la charpente , remplacement des tuiles.
En conclusion le président Jean Jacques SCHWIEN remercie l’ensemble des participants et les membres du bureau pour tout le travail accompli au cours du dernier exercice et se dit très heureux de voir l’équipe s’être renforcée par des personnes de qualité.
Le Président clôt l’Assemblée Générale à 20H25
Le président invite l’assistance à participer à la conférence de clôture :
L’ASSOCIATION pour la SAUVEGARDE de la MAISON ALSACIENNE
Par Denis Elbel
Fait à Ensisheim le 05 AVRIL 2022
La Secrétaire de Séance Le Président
Marie Hélène PEULTIER Jean Jacques SCHWIEN
Voeux du Président
12 janvier 2023SOCIETE D’HISTOIRE D’ENSISHEIM
Ensisheim, le 7 janvier 2023
Chers membres et amis,
Au début de cette nouvelle année, j’ai d’abord le plaisir de vous faire part de mes voeux les plus
sincères et les plus chaleureux, avec le souhait qu’elle vous soit favorable dans vos projets tant
professionnels que personnels.
Je vous fais part également des conférenceset activités programmées au cours de ce premier
semestre.
1 – Mardi 31 janvier, 20h15,
Dr Francis LEVY,
La présence juive à Ensisheim
2 – Mardi 11 avril, 19h, Assemblée Générale de la Société d’histoire,
suivie à 20h15 d’une conférence de
Bernard BOHLY, Archéologue,
Les mines de Wegscheid (vallée de Masevaux) à la fin du Moyen Âge,
35 ans d’investigations
Un programme plus précis avec résumé et illustrations de la première conférence est d’ailleurs joint
à ce courrier.
Vous aurez noté que, contrairement aux autres années, nous avons un nombre plus réduit de
conférences sur ce premier semestre. Nous devons en effet composer avec le planning chargé de la
Médiathèque (où se dérouleront ces conférences), du fait de la fermeture de la Régence, le temps des
travaux. Mais par ailleurs, même si notre Société n’en est pas directement à l’origine, je vous fais part
d’une conférence sur les Habsbourg à la mi février par nos voisins et amis de la Société d’Histoire de
Thann. Je vous préciserai date, horaire et titre dès que j’en saurai plus.
Pour les mêmes raisons de calendrier, nous avons aussi anticipé pour les conférences de l’automne,
qui auront lieu les mardis 17 octobre et 14 novembre. Là de même, vous aurez les précisions voulues
en temps et en heure.
Avec mes respectueuses salutations.
Le Président
Jean Jacques SCHWIEN
Site internet: http://www.associations-ensisheim.com/association/societe-dhistoire
Conférence du 11 octobre 2022 « Vivre à Rouffach en 1616 », par M. Gérard Michel, historien.
17 octobre 2022Conférence du 11 octobre 2022:
« Vivre à Rouffach en 1616, Histoire(s) et vie quotidienne du Rouffach d’Antan, à la veille de la Guerre de Trente Ans »,
par Monsieur Gérard MICHEL, historien.

Monsieur Gérard MICHEL
Le Palais de la Régence étant en travaux, c’est dans la salle de la médiathèque mise à disposition par la municipalité d’Ensisheim, que s’est déroulée la conférence donnée par M. Gérard Michel.
C’est un public intéressé , venu en nombre d’Ensisheim, mais également des villages environnants, ainsi que de Rouffach, qui s’est déplacé dans notre commune.



Le conférencier a situé son récit en 1616 car, pour lui, cette date correspond au basculement entre deux époques importantes : le « beau » 16ème siècle (avec l’épanouissement de la littérature, de la peinture, des arts…et une période relativement paisible) et le 17ème siècle, période troublée, notamment par la terrible Guerre de Trente Ans (1618-1648), qui a affecté durablement les provinces de l’Est…
A cette époque, le Saint Empire Germanique est constitué d’une mosaïque d’environ 350 états (terres d’Empire, villes libres, seigneuries, dont de nombreux territoires minuscules disséminés dans toute l’Europe centrale…)
La Haute Alsace était partagée entre l’évêché de Strasbourg, la famille des Habsbourg, celle des Ribeaupierre, les abbés de Murbach, ceux de Munster.
Les villes de Rouffach, Soultz et Eguisheim appartenaient à l’évêque de Strasbourg en tant que seigneur territorial (et réunies au sein d’une entité appelée l’Obermundat).
La ville de Rouffach, capitale de l’Obermundat.
- Michel a donné les explications suivantes en s’appuyant sur une légende:
Au VIIème siècle, le fils de Dagobert II, roi d’Austrasie, (Sigisbert, qui résidait vraisemblablement au château d’Isenbourg) a été blessé à mort par un sanglier lors d’une partie de chasse survenue à Ebersmunster, et a été ressuscité par Arbogast, évêque de Strasbourg.
En signe de reconnaissance face à ce miracle, Dagobert II a donné l’Obermundat à l’évêque de Strasbourg.
Rouffach est devenue capitale de l’Obermundat et l’est restée jusqu’à la Révolution.
La vie à Rouffach au 17ème siècle
C’est au travers de l’étude de nombreux comptes rendus anciens transcrits lors des séances hebdomadaires du Magistrat que M. Gérard MICHEL a su nous retranscrire la vie dans la cité de Rouffach dans les premières années du 17ème siècle.
A l’époque, la ville de Rouffach était entourée de fortifications, ainsi que de tours. On estime que le mur d’enceinte faisait 2151,80 mètres de longueur.
La population (non compris les vagabonds et indésirables) était estimée à environ 1800 personnes.
Le cours d’eau OHMBACH
L’Ohmbach, ruisseau qui prend sa source sur les hauteurs de Soulzmatt et qui traversait Rouffach, a joué un rôle important dans la cité. Il a permis l’im![]() plantation de nombreuses activités.
plantation de nombreuses activités.
Non seulement il alimentait moulins, tanneries, abattoirs, boucheries,… mais deux étuves (bains publics) étaient aussi installées sur son cours… A l’époque, où il n’y avait ni égout, ni collecteur, le cours d’eau jouait également un rôle dans l’assainissement, et nous pouvons imaginer les problèmes liés à l’hygiène…
De nombreux conflits découlaient de l’utilisation de l’eau, et des différents usages qui en étaient faits.
L’étude des incidents consignés a permis de savoir quelles étaient les activités, et de connaitre les suites données aux litiges …
Le Magistrat et le conseil municipal de l’époque
La ville était administrée par un conseil composé de 15 élus (dont certains de manière permanente), avec à sa tête le « Magistrat ».
Ensemble, ils géraient le quotidien des habitants, et veillaient aux règlements qui régissaient les activités.
Ils veillaient au bon emploi des finances, et avaient en charge la Justice de la ville.
5 postes étaient particulièrement importants et avaient un rapport avec les revenus financiers de la cité:
– Gewerfer: receveur de la Taille
– Umgelter :receveur de l’impôt indirect (vins)
– Kirchenpfleger : donations aux églises
– Spitalpfleger: gestion de la santé
– Gutleuthpfleger: gestion de la léproserie (« les bonnes gens »)
- Michel a précisé que les conseillers, à cette époque étaient issus de familles très fidèles au Magistrat, et que certains d’entre eux disaient ne savoir ni lire ni écrire, sans doute pour ne pas être tenus responsables d’erreurs dans leur gestion, en particulier dans le cas des sentences judiciaires (liée ici à leur « méconnaissance du droit »).
Durant son exposé, M. Michel a relaté de nombreuses anecdotes liées à la vie quotidienne des habitants; il a entre autre, évoqué l’obligation pour les habitants d’entretenir correctement leurs cheminées sous peine d’amendes, ainsi que les « Schlupf » (le passage étroit entre deux maisons), précisant que ces « Schlupf » servaient également de collecteurs pour certaines ordures que les cochons se chargeaient de nettoyer…
Le conférencier a également évoqué la façon dont était rendue la justice, et les sanctions qui pouvaient en découler :
– Les offenses et délits étaient sanctionnés parfois par une amende variable, d’autres fois par une humiliation publique (port d’un carcan dans les rues de la ville, exposition à la vie de tous…)
– Le bannissement était parfois prononcé pour certaines personnes, une sanction leur interdisant de revenir sur le territoire de la ville. Cette mesure peut aujourd’hui semble anodine mais équivalait alors à une mort civile: les bannis n’avaient plus de droits et quiconque pouvait les maltraiter voire les tuer sans risques judiciaires.
– Les crimes étaient sévèrement punis ( prison, châtiments corporels , voire exécution); mais les sentences de mort étaient toutefois bien moins nombreuses qu’on ne se l’imagine aujourd’hui. Le tribunal s’appuyait en effet sur des textes juridiques précis et rigoureux, mis en place par l’empereur Charles Quint vers 1550..
Comme dans de nombreuses autres cités, Il existait un gibet à Rouffach, où les suppliciés étaient exposés, situé non loin du château de l’Isenbourg; seules les sorcières étaient exécutées dans un lieu à part, hors la ville. Il y avait de même un bourreau, chargé des exécutions de divers types (décapitation, noyade, mise au bûcher, enfouissement, écartèlement…).

Les jour fériés, « Tanzen und Springen »
A l’époque, les jours de fêtes étaient nombreux et chômés, avec interdiction d’effectuer certaines tâches, soit environ 1/3 des journées de l’année . Les habitants de la cité se devaient, en outre, d’assister aux processions et aux offices religieux avec leur famille et leurs personnels sous peine d’amendes.
Les jours de fête étaient l’occasion de réjouissances diverses, pour la population, mais toujours encadrées par des règlements.
La population aimait se divertir au travers de jeux de dés, de quilles, des jeux de force, de lancer de poids…
- Michel a évoqué un exercice très prisé par la population : le tir.
Cette activité attirait de nombreux amateurs qui n’hésitaient pas à venir depuis les villages environnants, et parfois de villes plus lointaines. Les pièces d’armement étaient essentiellement des mousquets ou des arquebuses, l’activité se pratiquait dans le fossé de la ville. Les vainqueurs étaient parfois récompensés par un prix qui était quelquefois un boeuf qu’ils emportaient alors dans leur village.
La ville de Rouffach ne manquait ni d’auberges, ni de cabarets; on y buvait, on y jouait, et, bien sûr, des abus y étaient parfois constatés, comme des bagarres, ou des faits de prostitution .
Ces faits étaient souvent sanctionnés.
Conclusion
- Michel, au travers de ses recherches, nous a fait revivre le quotidien des hommes dans leurs activités, à Rouffach, au début du 17ème siècle.
Si certains éléments nous apparaissent bien lointains, le mode de vie et les préoccupations des bourgeois de Rouffach ont de grandes similitudes avec les nôtres.
Une grande partie des fortifications a été détruite en 1803, mais il reste encore de nos jours de nombreux vestiges du Rouffach d’antan.
Il est à préciser que les recherches de M. Michel sont consultables sur le site internet qu’il a créé:
obermundat.org
Conférence du mardi 5 avril 2022, par M. Denis ELBEL, vice président de l’Association pour la Sauvegarde de la Maison Alsacienne
21 avril 2022Conférence ASMA du mardi 5 avril 2022
La Société d’histoire d’Ensisheim remercie la municipalité d’Ensisheim d’avoir mis à disposition la salle du Palais de la Régence pour son Assemblée Générale.
Selon une tradition bien établie, l’AG a été suivie d’un conférence, à laquelle ont assisté une cinquantaine de personnes. C’était aussi notre première conférence de l’année, les précédentes ayant été annulées pour cause de Covid.
Elle a été consacrée à L’Association pour la Sauvegarde de la Maison Alsacienne (ASMA) et présentée par son vice-président Denis ELBEL.
Créée en 1972, l’ASMA fête cette année ses 50 années d’existence.
Son objectif est : »Apprendre, comprendre et défendre la Maison Alsacienne, aujourd’hui et demain ».
Tout au long de la soirée, Denis ELBEL a transmis à un public attentif sa passion pour la préservation de la maison alsacienne, et a détaillé le combat que mène son association au quotidien afin d’éviter qu’une partie du patrimoine de notre région ne disparaisse à jamais dans l’indifférence générale.

M. Denis ELBEL, Vice Président de l’ASMA
1.- Le volet pédagogique
Au travers de Stammtisch organisés régulièrement et ouverts à tous, sont présentés les projets pour la restauration du bâti ancien des participants, donnés des conseils et proposées des solutions concrètes.
L’ASMA s’appuie sur des personnes ayant des compétences dans des domaines très divers (maçons, charpentiers, couvreurs, ferronniers, plâtriers, architectes, maitres d’œuvre,…), car la restauration et la préservation des bâtiments anciens obéissent à des règles strictes, des erreurs trop souvent commises dans le passé étant à éviter.


L’ASMA organise des stages de formation aux différentes techniques de restauration
L’isolation des bâtiments est d’une très grande importance, et l’utilisation de matériaux inappropriés (et parfois onéreux) peut entrainer des dégâts particulièrement destructeurs. L’isolation par l’extérieur avec des plaques de polystyrène (ou tout autre matériau de ce type) est à proscrire pour le bâti ancien. En effet, la vapeur d’eau générée à l’intérieur de l’habitation, en particulier au droit de la cuisine et de la salle de bains, ne pourra plus s’évacuer au travers des murs. La conséquence pour une maison à colombages est dramatique : les pans de bois vont pourrir, et même du chêne de plus de 300 ans va assez rapidement se transformer en bois vermoulu !
La solution idéale a été mise au point en Bretagne depuis une vingtaine d’années par l’Association ‘’Construire en chanvre’’: c’est la projection par l’intérieur d’un mélange de chaux et de chanvre, qui permet d’isoler parfaitement, souvent à moindre coût, et permet au bâtiment d’évacuer l’humidité. Cette technique permet d’obtenir de la perspirance. Ce matériau est appelé quelquefois ‘’béton de chanvre’’, puisque le terme ‘’béton’’ désigne au départ un matériau constitué d’un mélange d’agrégats (ici la paille de chanvre hachée) et d’un liant (ici de la chaux). Il faut éviter l’utilisation du ciment qui rendrait le mélange étanche et non perspirant.
Le problème est analogue pour tous les enduits, que ce soit en intérieur ou en extérieur : là aussi, il faut proscrire le ciment. Nos ancêtres n’utilisaient qu’un mélange de sable et de chaux, ce qui a assuré la pérennité de leurs maisons.
Le ciment reste par contre une excellente solution pour le renforcement de fondations ou des reprises en sous-œuvre, et tout particulièrement en terrain humide.
Le ‘’chaux-chanvre’’ peut également être utilisé dans le comblement des espaces entre les colombages, qu’on appelle les « miroirs », ce qui améliore encore l’isolation.
L’ASMA organise aussi régulièrement des stages de formation pour les personnes désireuses d’acquérir un savoir faire, entre autres la technique du torchis avec son armature en bois (les palançons) destinée à accrocher l’argile. Ces personnes pourront ainsi réaliser elles-mêmes à moindre coût les travaux dont elles ont besoin, puisque c’est la main d’œuvre qui est onéreuse et non les matériaux mis en œuvre.
Denis ELBEL a expliqué que l’ASMA informait aussi les particuliers sur les démarches administratives, les différentes aides possibles, dont les réductions d’impôts au travers, par exemple, du ‘’Label Fondation du Patrimoine’’.
Avec le chantier de sa propre maison érigée en 1717, il a également pu démontrer qu’un bâtiment à colombages pouvait obtenir le label « BBC – Bâtiment Basse Consommation ». Son expérience a été présentée au colloque de création du CREBA à Bordeaux en novembre 2018. Le CREBA ou ‘’Centre de Ressources pour la Réhabilitation Responsable du Bâti Ancien’’, est une plateforme en ligne pilotée par l’Etat pour diffuser les bonnes pratiques dans ce domaine, en tenant compte des enjeux non seulement patrimoniaux, mais également énergétiques, via des retours d’expérience sur des opérations exemplaires.

M. Denis ELBEL et M. Jean Jacques SCHWIEN, Président de la Société d’Histoire d’Ensisheim
2.- Le volet défensif
Tous les moyens sont mis en œuvre par l’ASMA pour tenter de sauver un bâtiment ancien de la démolition.
Les maires sont systématiquement contactés en priorité ; ils n’ont pas toujours l’information qui leur permettrait de s’opposer aux permis de démolir sollicités par les citoyens de leur commune, mais certains maires ne sont tout simplement pas sensibles à la notion de patrimoine à préserver.
Au delà des élus, la pédagogie est menée à différents niveaux, notamment auprès des lycéens, par exemple une conférence donnée devant les élèves du Lycée agricole d’Obernai.
L’ASMA n’hésite pas à faire parler d’elle lorsque le combat s’avère difficile ; les médias vont alors être sollicités pour relayer les arguments en faveur de la préservation. Toutes les énergies sont utilisées afin de sensibiliser le maximum de personnes à la conservation du patrimoine. Ainsi, le journaliste Jean-Pierre PERNAUT et l’animateur Stéphane BERN ont, à de multiples occasions, soutenu le travail – disons plutôt le combat – de l’ASMA.
L’ASMA intervient dès qu’elle est informée qu’un projet de démolition concernant un bâtiment ancien est engagé; ce sont souvent ses propres adhérents qui assurent ce rôle de ‘’sentinelles’’.
L’ASMA a de nombreux succès à son actif. Mais des exemples navrants de disparition définitive de l’habitat ancien sont à déplorer dans plusieurs communes (Brunstatt, Geudertheim, Vœgtlinshoffen, Spechbach-le-Bas…). Mais pour ce dernier cas, qui remonte à juillet 2021, un recours au Tribunal administratif est toujours en cours d’instruction pour faire condamner le maire : il a cumulé les irrégularités en faisant démolir une maison à colombages du 17ème siècle, propriété de la commune, située juste à côté de l’église, en ne respectant ni les délais légaux du permis, ni la protection de cette maison au titre du Plan local d’urbanisme (PLU) de la commune !

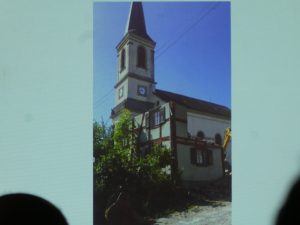
exemple d’un bâtiment détruit
Les perspectives d’avenir
Malgré ces échecs, Denis ELBEL reste confiant en l’avenir.
De plus en plus de personnes sont sensibilisées à l’idée de devoir préserver le patrimoine ancien, et le nombre de membres de l’ASMA augmente au fil des années ; le cap des 1000 adhérents sera en effet très probablement franchi au cours de cette année du cinquantenaire.
Des projets de sauvegarde, de transformation ou de modification de bâtiments anciens dans le souci de leur mise en valeur ont pu être élaboré.
Denis ELBEL cite le cas de Mommenheim, où le projet d’extension d’une boulangerie a pu se faire en démontant la maison à pans de bois, remontée sur le même site douze mètres plus loin, tout en adaptant la parcelle aux besoins de l’outil de travail du boulanger. Il rappelle à cette occasion que sous l’Ancien Régime, les notaires considéraient les maisons à colombages comme des biens meubles, et non pas des immeubles.
Dans la commune de Lembach, où l’ancien maire Charles SCHLOSSER avait très tôt pris conscience de la valeur du bâti ancien, non seulement le bâti a pu être préservé (13 maisons sauvegardées en 20 ans) mais il s’est dégagé une véritable plus-value pour la commune, dans le sens où elle attire désormais dans ses gîtes « typiques » alsaciens une clientèle de tourisme sensible à ce type d’habitat.
Cette démarche a pu être mise en pratique à l’échelle de la Communauté de Communes du Kochersberg, à l’occasion de la mise en place de son PLUi ; 1500 bâtiments anciens, aussi bien à colombages qu’en pierre, sont désormais protégés dans ses 33 villages. La Communauté de Communes du Sundgau, forte de plus de 70 villages, s’est déclarée prête à suivre cet exemple, qui constitue effectivement une véritable solution d’avenir pour la sauvegarde de nos maisons anciennes, qui marquent l’originalité de l’Alsace.
Il est à noter également que le président de la Collectivité Européenne d’Alsace, Frédéric BIERRY, a exprimé fin novembre 2021 son soutien à l’ASMA, qu’il a concrétisé au travers d’un partenariat pour le projet d’édition d’un recueil des ‘’bonnes pratiques’’ , allant même jusqu’à faire adhérer la CeA à l’association !
Une référente a de même été nommée : il s’agit de la Conseillère d’Alsace et Sénatrice Sabine DREXLER de Durmenach. Son rôle est centraliser les questions posées en termes de conservation de la maison alsacienne et d’aider à trouver les solutions en cas de besoin.
Ces éléments portent à croire qu’une collaboration constructive sera possible dans l’intérêt d’une plus grande préservation du patrimoine alsacien.
PS : Pour soutenir l’ASMA, vous pouvez adhérer pour la modique somme de 30€, qui, notre association étant reconnue d’utilité publique, représentera au final un ‘’reste à charge’’ de 10€ seulement par l’établissement d’un reçu fiscal. Notre adresse : www.asma.fr
conférence du mardi 12 octobre 2021: « Deux siècles d’industrialisation et de désindustrialisation en Alsace » par M. Nicolas Stoskopf
25 octobre 2021
Après plusieurs mois d’interruption causée par la crise sanitaire, le cycle des conférences proposées par la Société d’histoire d’Ensisheim a pu reprendre.
A la suite de l’ AG du 12 octobre 2021, nous avons ainsi pu accueillir M. STOSKOPF, professeur émérite à l’Université de Mulhouse, et spécialiste de l’histoire de l’industrie, sur le thème « Deux siècles et demi d’industrialisation et de désindustrialisation en Alsace».
Nous remercions la ville d’Ensisheim d’avoir mis à disposition la salle de la Régence et avons eu le plaisir d’accueillir une trentaine de personnes munies de leur passe sanitaire.
M. Stoskopf commence par expliquer qu’il n’y a pas l’industrialisation d’abord et la désindustrialisation ensuite, mais que les deux mouvements sont étroitement liés : quand la filature se mécanise au début du XIXe siècle, des milliers d’emploi de fileuses à domicile sont détruits…Ce qui compte pour un territoire, c’est le solde entre les deux mouvements. A l’échelle de la France, le tournant majeur se produit en 1974. En Alsace, il faut aussi se poser la question de l’impact des guerres et des changements de nationalité.
Il appuie sa démonstration sur des cartes réalisées pour l’Atlas historique d’Alsace, accessible en ligne ( http://www.atlas.historique.alsace.uha.fr/fr/ ) et en version papier publiée en 2019 (sous la direction d’Odile Kammerer).
Deux modèles principaux d’industrialisation caractérisent l’Alsace : dans les trois villes réformées, Mulhouse, Sainte-Marie-aux-Mines et Bischwiller (Bas-Rhin), un mouvement collectif mobilise les entrepreneurs pour produire un produit nouveau demandé par le marché : ainsi à Mulhouse, la fabrication des indiennes (toiles imprimées) à partir de 1746 déclenche une véritable révolution industrielle (filature, tissage, impression, chimie, constructions mécaniques) qui se répand dans les vallées vosgiennes et jusqu’à Colmar.
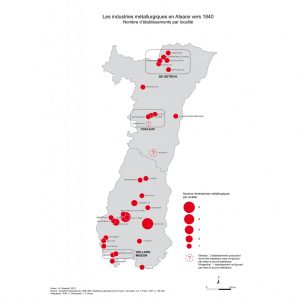
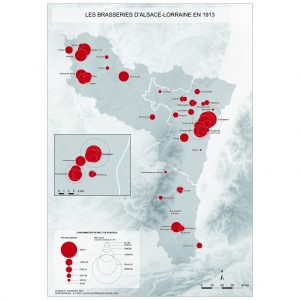
Au contraire, dans le Bas-Rhin, c’est un mouvement lent (et peu visible…) d’accumulation d’activités traditionnelles et artisanales mises en œuvre par une population essentiellement rurale, dispersée, mais également en surnombre et intéressée par des activités pouvant lui procurer un complément de ressources. Aux moulins, brasseries, tanneries, tuileries, poteries, etc… (souvent dirigés par des petits patrons protestants luthériens) s’ajoute le travail à domicile (tressage de chapeaux de paille en Alsace bossue, chaussons à Wasselonne, bonneterie à Barr, etc…). Finalement, ces activités font vivre autant de monde que la grande industrie haut-rhinoise vers 1870.
Ainsi les deux départements présentent des physionomies différentes :
les brasseries se trouvent surtout dans le Bas-Rhin, alors que le textile est concentré dans le Haut-Rhin.
Les guerres ont des répercussions sur la production industrielle.
L’annexion en 1870 a eu, dans un premier temps des conséquences négatives, car certaines productions (indiennes) étaient destinées au marché français .
Certains industriels ont quitté l’ Alsace pour s’installer ailleurs (et parfois avec leurs ouvriers comme c’est le cas pour une entreprise de Bischwiller partie avec les ouvriers s’installer à Elbeuf , dans la région de Rouen !) . Des investissements sont alors effectués dans les Vosges ou dans le Territoire de Belfort… Mais des investisseurs allemands apparaissent, intéressés d’abord par le secteur pétrolier (Pechelbronn). Strasbourg et sa banlieue connaissent une grande expansion: agro-alimentaire, industries d’équipement, entrepôts de charbon…Certaines entreprises deviennent des géants comme la SACM à Mulhouse.
La guerre de 14-18 est très difficile pour l’industrie alsacienne (proximité du front, manque de matières premières, méfiance des Allemands).
En 1918, les industriels allemands sont expulsés après le retour de l’Alsace à la France. Suit une période compliquée entre les deux guerres mondiales : certaines branches s’en sortent bien (brasseries, métallurgie), mais le textile doit trouver des débouchés sur les bouchés coloniaux.
Les « 30 glorieuses » (1945-1973) seront en Alsace synonyme de déclin pour de nombreuses entreprises et de mutations industrielles pour d’autres : la crise du textile entraine la fermeture définitive de nombreuses usines parvenues à bout de souffle et qui appartiennent désormais au passé.
Mais des industries nouvelles apparaissent notamment sur les bords du Rhin : à Chalampé, Ottmarsheim, Fessenheim, Strasbourg…
On rêve d’implantation massive d’industries lourdes pouvant faire de l’Alsace « un nouveau Texas ».
Des société étrangères s’intéressent à l’Alsace et des nouveaux noms apparaissent : TIMKEN, GENERAL MOTORS, MARS, LIEBHERR…
Pendant qu’on détruit l’ancienne industrie, une nouvelle se met progressivement en place, et globalement, la création d’emplois industriels reste positive.
Pourtant des signes inquiétants apparaissent : les mines de potasse, dont la production était destinée au secteur agricole, disparaissent en 1998, la SACM (10 000 emplois en 1955) est démantelée en 1965, des grands fleurons comme DMC ne sont plus sous contrôle alsacien, la famille HATT cède Kronenbourg…
A partir de 1974, malgré une vague de désindustrialisation, le chômage en Alsace n’est pas aussi élevé qu’ailleurs, du fait de l’embauche de nombreux Alsaciens en Suisse ou en Allemagne.
D’autre part on assiste à cette époque à un nouveau flux d’investissements étrangers : des Américains, des Suisses, des Allemands ainsi que des Japonais (notamment dans le vignoble) s’installent à leur tour pour développer leurs entreprises.
Cependant depuis 2002, on ne peut que constater une baisse continue de l’emploi industriel, malgré pourtant, la bonne implantation de nombreuses entreprises..
Le capitalisme « dynastique » a désormais fait place à un capitalisme « viager » :
entre 2002 et 2010, l’Alsace aura perdu près de 40 000 emplois industriels; son réseau d’entreprises moyennes et familiales a tendance à disparaître, ainsi que la transmission inter générationnelle.
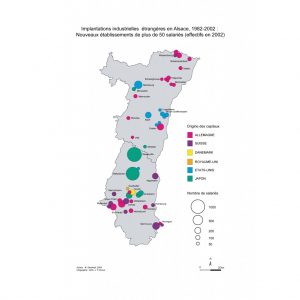
L’Alsace reste une région industrielle importante, mais son taux de chômage a augmenté et nous devons constater un décalage d’avec le modèle rhénan que peut représenter le Bade -Wurtemberg par exemple.
Malgré ses atouts et son attractivité (diversité du tissus industriel et ses activités, importance des PME et artisanat, qualité de la main-d’œuvre) le solde d’activité apparait aujourd’hui négatif, et l’investissement étranger ne suffit plus à assurer le renouvellement du tissu industriel.
Conférence du mardi 13 octobre 2020, par M. Florent MINOT, archéologue : « les fouilles archéologiques récentes au centre ville d’Ensisheim »
12 novembre 2020Conférence du 13 octobre 2020 :
» les fouilles archéologiques récentes au centre-ville d’Ensisheim » par M. Florent MINOT d’Archéologie Alsace

C’est dans le respect des règles sanitaires actuelles que le public composé d’environ 70 personnes a pu assister à la conférence de M. Florent Minot, archéologue à Archéologie Alsace.
Pour l’occasion, la ville d’Ensisheim avait une nouvelle fois mis la salle de la Régence à disposition de la Société d’Histoire.
Dans son exposé , M. Minot a expliqué le travail de recherches mené ces dernières années sur plusieurs sites à Ensisheim.
Il a rappelé que la ville était riche de son patrimoine et de son histoire et a cité quelques dates importantes:
-la première mention du nom d’Ensisheim remonte à 765 (villa)
-en 1213, il est fait mention pour la 1ère fois d’un lien entre les Habsbourg et Ensisheim
-en 1263 , mention d’un fief castral à Ensisheim
-en 1351 , le château y est mentionné explicitement
-en 1360-1380, le fossé
-en 1420, des tours
-en 1433, existence d’une chancellerie
-en 1537, existence de l’arsenal
-en 1584, création de l’atelier monétaire
-entre 1631 et 1638, la ville est plusieurs fois assiégée
-au 18éme siècle, l’enceinte est démantelée
Le conférencier a poursuivi son exposé en précisant que les sites étudiés avaient été :
-le site de l’ancien château (diagnostic de 2016)
-le site de la médiathèque (fouilles de 2018)
-le site de l’ancienne scierie SCHMIDT (fouilles de 2019)
l’ancien château
Le château est aujourd’hui disparu, et ne subsistent désormais que quelques pans de murs (et le fossé intérieur), visibles dans le parc de l’hôpital.
Les fouilles pratiquées ont néanmoins permis d’identifier une construction datant du 13ème siècle. Des murs épais ont été dévoilés ((2,10 m de largeur), ainsi qu’une fondation maçonnée, et un mur d’escarpe d’une hauteur de 4,80 m. D’autres éléments ont été observés, comme des latrines, et en sous-sol, une grande partie des fondations ont été conservées.
Le château a été détruit au 17ème siècle, et a ensuite servi de carrières aux habitants d’Ensisheim pour leurs habitations.
Le site de l’ancienne scierie Schmidt
-Les recherches dans la propriété ont livré des traces importantes de l’enceinte médiévale.
Les dépotoirs de céramiques étudiées placent l’origine des fortifications au 13ème siècle, avec des travaux ultérieurs au 14ème siècle.
Ces éléments permettent donc de confirmer la fondation de la ville vers 1272.
Le mur d’enceinte a ensuite été consolidé, modifié ou reconstruit à différentes périodes.
Un bâtiment proche des fortifications a également pu être identifié au travers de ses fondations ; les éléments dégagés prouvent qu’il avait pu être luxueux , il est probable qu’il s’agisse du bâtiment de la chancellerie détruit lors de la guerre de Trente ans.
les fouilles sur le site de la médiathèque
Les travaux des archéologues y ont dévoilé huit siècles d’occupation du centre ville.
Les premières traces remontent au 13ème siècle, sous la forme de vestiges « en creux » (fosses), et de traces de poteaux en bois; la présence de scories et battitures suppose l’existence d’un atelier de « type forge » . Sur le reste de la parcelle, on suppute aussi des jardins et des enclos pour animaux.
A partir du 15ème siècle se sont développées des habitations avec caves (une colonne en grès soigneusement ouvragée, servant de soutien aux poutres d’une cave, a été mise à jour).
Divers équipements comme des latrines et puits ont également été observés, dont l’un des intérêts est de déterminer une partie de l’alimentation des habitants de l’époque, grâce aux objets (vaisselle) et restes organiques (graines…).
Ces habitats sont détruits au 17ème siècle, vraisemblablement à cause des événements dus à la Guerre de trente ans.
C’est dans ces vestiges qu’a été découvert un dépôt monétaire exceptionnel. Il s’agit d’un lot de 179 monnaies (dont 66 thalers), sans doute cachées du fait de la guerre (sous un plancher?), et réunies (à l’origine) dans une bourse en cuir ou tissu. Particulièrement bien conservées, leur poids total (avant tout de l’argent) est de 2,237kg. Ces monnaies sont pour l’essentiel d’origine locale, pour d’autres d’Europe centrale. La plus ancienne date des années 1510-1530; la plus récente a été frappée en 1631. Au total, ce vrai trésor apparait aujourd’hui comme la plus importante découverte archéologique de thalers.
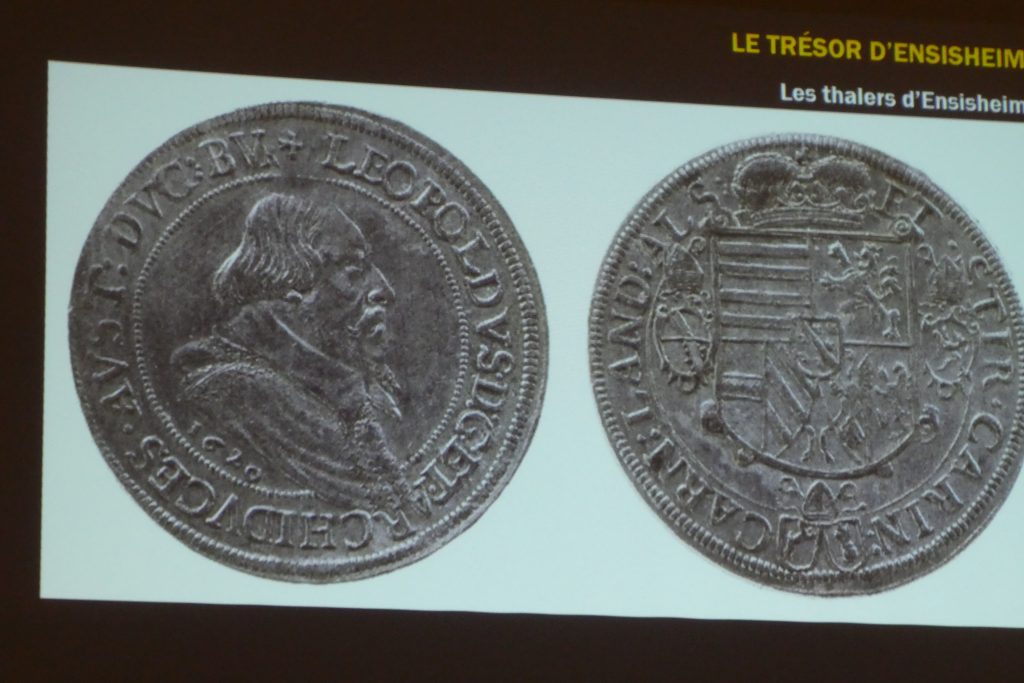
Il est actuellement en cours d’analyse afin de déterminer la composition des métaux, et leur provenance (analyse isotopique).
Par la suite, le quartier est réorganisé du 17ème au 19ème siècle, avec la construction de nouvelles habitations. Mais il s’y est aussi développé une activité artisanale de fonte de cloches, apparemment dans la 2ème moitié du 18ème siècle. Selon les empreintes de quatre moules, on y a réalisé des cloches de respectivement 1,40m, 1,15m, 0,95m et 0,70m de diamètre. On n’en connait pas la destination (église d’Ensisheim ou autre). M. Minot a d’ailleurs détaillé longuement les techniques mises en oeuvre pour cette activité particulière.
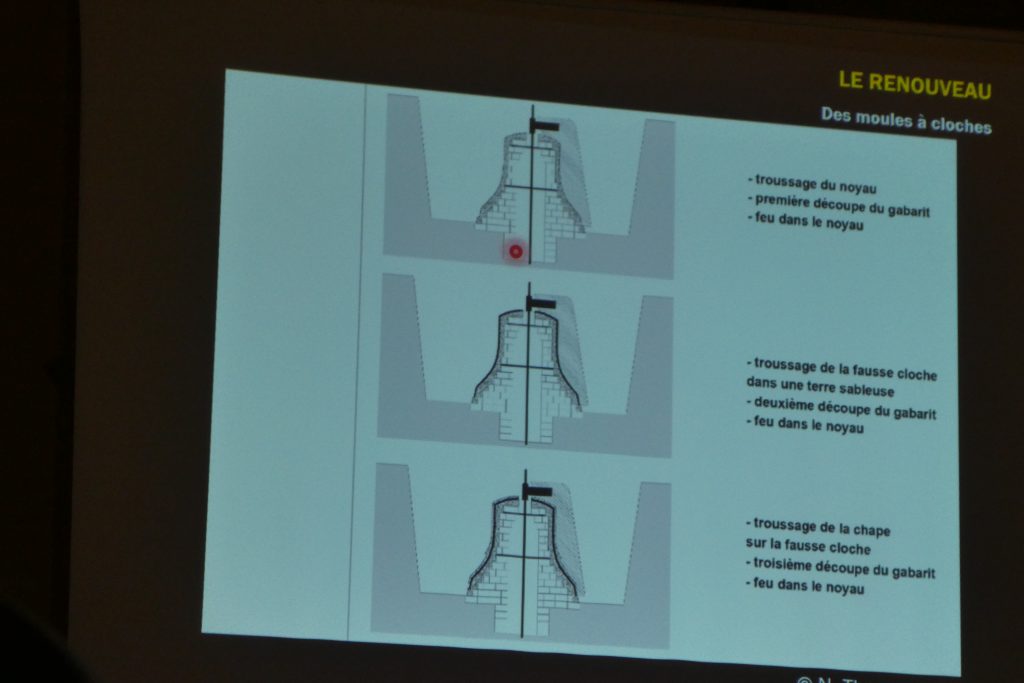
Synthèse
Les études menées au travers des fouilles de ces récentes années ont donc permis, pour la première fois, de confirmer par l’archéologie la date supposée de la fondation de la ville d’Ensisheim, contemporaine de son château et de ses remparts.
Il en ressort que la ville a connu son apogée politique et économique aux 15ème et 16ème siècles avant de subir les destructions de la Guerre de trente ans. Ensisheim, par la suite, ne parait pas par la suite avoir recouvré le niveau de vie des siècles précédents.
Des questions et un débat ont suivi l’exposé passionnant de M. Minot .
Conférence du 28 janvier 2020 par M. Patrick Unterstock
8 février 2020Conférence du 28 janvier 2020, palais de la Régence, Ensisheim,
par M. Patrick UNTERSTOCK
Les usages de l’Ill entre Colmar et Strasbourg
(navigation, pêcheries, moulins).


C’est dans la salle du Palais de la Régence mise à disposition par la ville d’Ensisheim que s’est déroulée la 1ére conférence de la Société d’Histoire d’Ensisheim de l’année 2020.
Une soixantaine de personnes sont venues écouter la conférence de Monsieur Patrick Unterstock, batelier professionnel et calfat à Muttersholtz.
Dans un premier temps, le conférencier a évoqué le rôle important de la rivière Ill au fil des siècles.
L’Ill, qui traverse l’Alsace du Sud au Nord, déroule ses longs méandres sur plus de 200 kms, avec un dénivelé de 142 mètres (la hauteur de la cathédrale de Strasbourg), avant de se jeter dans le Rhin (actuellement) à Gambsheim.
Alimentée par 908 affluents, dont les plus importants sont la Largue, la Doller, la Thur, la Lauch, la Fecht, la Weiss, la Lièpvrette, le Giessen, l’Andlau, la Bruche, la rivière est également nourrie dans la région de Sélestat par des résurgences de la nappe phréatique dont la température constante, été comme hiver, est de 10-12° C.
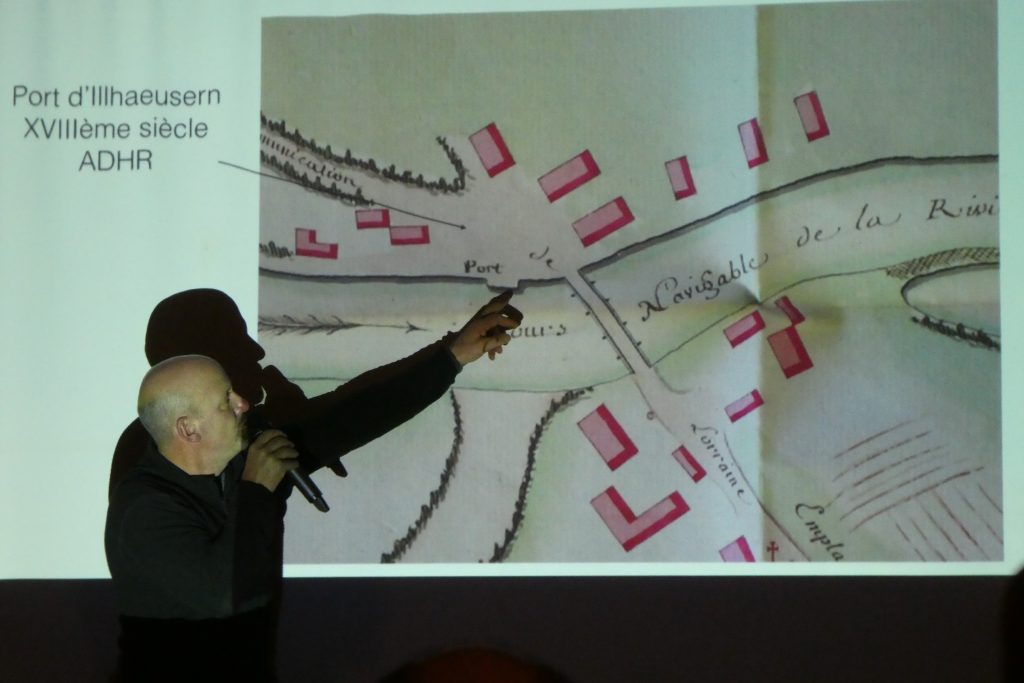
A certaines périodes de l’année, l’Ill est en crue, à d’autres elle peut être à sec et disparaitre en partie dans le sous-sol, et alimenter à son tour la nappe phréatique. En été, à certains endroits, l’Ill est profonde de plus de 4 mètres, à d’autres, le fond n’est que de 10 cm…
A l’époque romaine étaient déjà mentionnées les villes d’Argentovaria (Horbourg-Wihr), Elvetum (Ehl-Benfeld), Argentoratum (Strasbourg), toutes situées sur les rives de l’Ill. Les romains naviguaient donc déjà sur la rivière… essentiellement depuis Horbourg jusqu’à Strasbourg.
L’origine du mot « Alsace » proviendrait du mot « Ill » (« Ell-sass« , le lieu où est assise l’Ill), de même que certains noms de localités (Illzach, Illfurth, Illhausern, Illkirch, Elsau…). Mais cette explication est trop simpliste voire incompatible avec la linguistique.
Au Moyen Age, le commerce y était intense, ainsi que les activités de pêche et meunerie.
En 1332 fut crée la corporation de l’Ancre à Strasbourg, qui regroupait les bateliers.
En 1404, le Syndicat de l’Ill (Illgenossen ou Ilsassen) voit le jour, des chartes de constitution sont élaborées (Illordnung) ; des visites annuelles (Illbesichtigung ), avec procès verbaux, sont alors instaurées en présence des professionnels concernés, des villes et des seigneurs riverains.
Plusieurs villes ellanes possédaient leur Ladhof (bassin portuaire) : Colmar, Sélestat, Strasbourg. Des réglementations se sont imposées très tôt pour prévenir les conflits ou tenter de les régler car les intérêts des différentes corporations étaient bien souvent antagonistes ; il est fait état dans les écrits, de conflits plus ou moins violents entre les meuniers et les bateliers.
En effet, dans le lit navigable, les bateliers exigeaient un passage de 22 à 28 pieds (soit 7-8 m) sans encombres. Ils accusaient les pêcheurs d’entraver l’écoulement normal avec des digues formées de pieux et fascines. Aussi, ils étaient constamment en conflit avec les meuniers qui détournaient à outrance le débit de l’Ill aux biefs en faveur de leurs moulins.
Pour favoriser les activités des professionnels, une organisation spécifique a dû être mise en place pour le nettoyage régulier des berges, le ramassage des objets indésirables (souches, troncs d’arbres..). On a essayé de normaliser les pertuis, d’aménager les écluses, les biefs, renforcer les berges, couper les méandres , installer des systèmes de cabestan…
En ce qui concerne les pêcheries, le poisson était abondant et les espèces variées : des lottes de rivière, barbeaux, anguilles, écrevisses… On pêchait au filet, à la nasse (Wartloff), au carrelet (Sitzberen), avec des digues (Fach), à la balance…
Il existait des droits de passage ou de pontenage et 4 péages perçus à 4 endroits : Illhaeusern, Sélestat, Ebersmunster, Graffenstaden, au profit des villes et des seigneurs locaux.
Au 16ème siècle, le commerce y était florissant ; les marchandises transportées étaient de tous ordres, mais l’Alsace exportait surtout des vins (un foudre ou Fuder strasbourgeois valait 1 200 litres) à destination de la Hollande et des pays Baltes. Un bateau de type rhénan (Lauertanne) pouvait emporter vingt à quarante foudres.
En retour, il était fréquent de retrouver sur les embarcations des produits comme le sel, des étoffes, du fromage ou des harengs.
A l’époque, le voyage entre Colmar et Strasbourg nécessitait 3 jours, mais il fallait 5 jours pour la remonte. Pour cette remontée, les embarcations étaient souvent halées par des hommes équipés de harnais appelés « bricoles », qui devaient s’épuiser à affronter les forces plus ou moins grandes des courants ainsi qu’aux installations de « Tich » où les cabestans étaient sensés faciliter le franchissement de ces seuils d’eau.
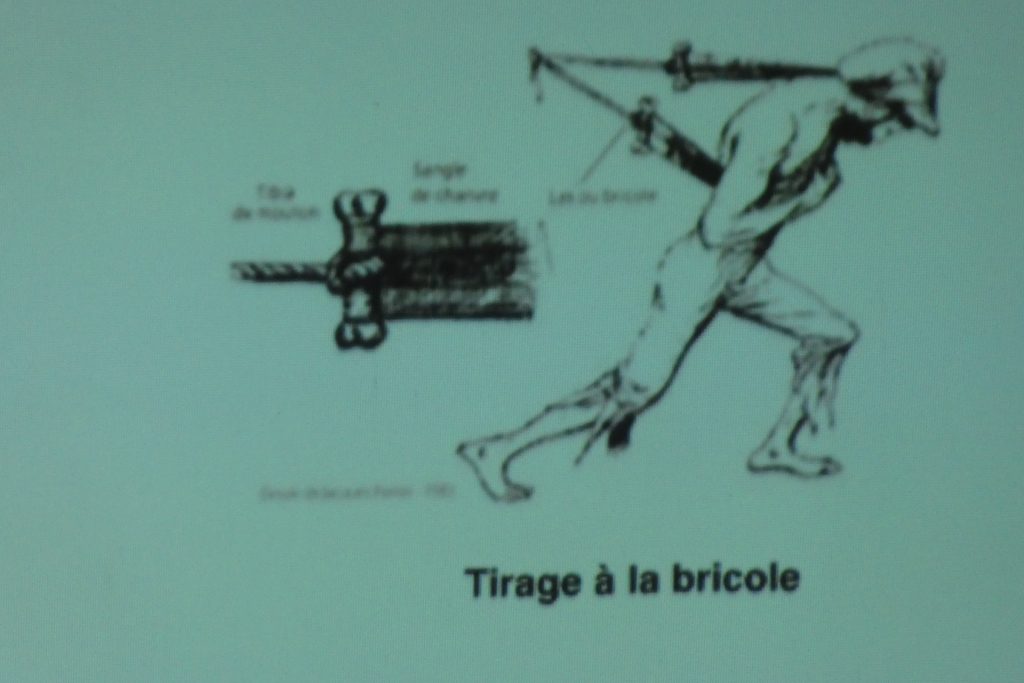
La navigation s’effectuait parfois de nuit et était plus ou moins intensive selon les saisons et les évènements (foires de Francfort ou de Strasbourg…).
Au 17éme siècle, après la Guerre de Trente ans, les contrôles de la rivière se sont espacés faute de moyens ; à l’époque, l’enceinte de la ville de Colmar est démantelée, celle de Sélestat est bastionnée… Avec la conquête de l’Alsace par Louis XIV, les échanges avec les pays du Nord européen s’étaient complexifiés en raison des oppositions du royaume de France avec celui du Saint Empire Romain Germanique et celui d’Espagne.
La navigation sur l’Ill s’est cependant poursuivie jusqu’au 19ème siècle avec les services des ponts et chaussées ; le transport des marchandises a ensuite été concurrencé par la construction du canal du Rhône au Rhin et la voie ferrée qui autorisaient des volumes plus importants.
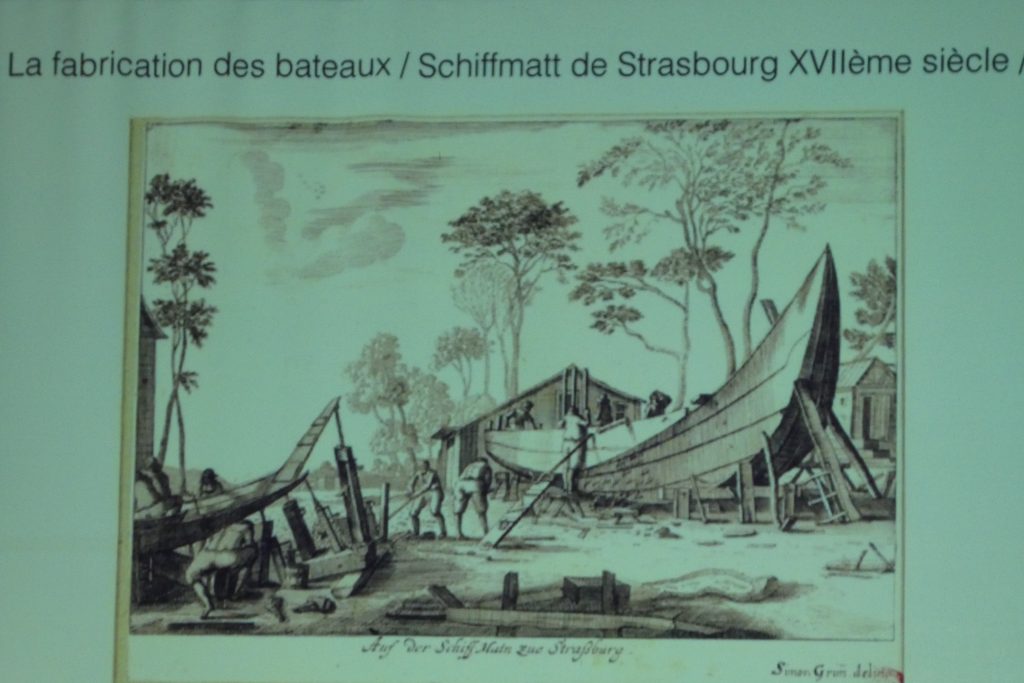
La qualité de l’eau n’a pas toujours été optimale au fil des siècles, car les cloaques des villes, les tanneries, les effluents engendrés par les nombreuses écuries, les déchets de toutes sortes étaient déversés dans les rivières ; certaines espèces aquatiques toutefois pouvaient s’en accommoder…
Mais la pêche professionnelle s’est réduite, surtout après la 2ème guerre mondiale, par l’utilisation massive des engrais chimiques, des produits phytosanitaires, des métaux lourds qui, entrainés par les eaux de ruissellement, se sont révélés progressivement destructeurs des milieux aquatiques…
Dans la deuxième partie de son exposé, M. Unterstock nous fait part de ses activités professionnelles et de ses compétences en matière de construction d’embarcations.
Il est le dernier constructeur de bateaux à fond plat (appelés plates) et perpétue une tradition en voie de disparition. Il a acquis le savoir-faire par la transmission auprès d’un ancien qui le détenait encore, et en reproduisant à l’identique les constructions d’antan. Dans son atelier de Muttersholtz, M. Unterstock construit à la demande des plates de 5 à 12 et même 14 m de longueur.
Lors des nombreuses questions qui lui ont été posées, le conférencier a expliqué qu’il choisissait lui même avec soin les arbres, avant de les faire couper, les faire scier, les faire sécher, avant qu’ils ne deviennent matériaux de construction.

L’essence utilisée est le pin sylvestre, ou le pin douglas, avec certains éléments en chêne. L’étanchéité (calfatage) est réalisée au moyen de roseaux appelés « massettes » (Knoschpe) et du chanvre. L’assemblage est fait à l’aide de clous forgés (autrefois de chevilles en bois). Tous les matériaux utilisés sont de provenance locale.
Certaines des réalisations de M. Unterstock sont utilisées par des particuliers qui ont passé commande, mais il est possible de voir les embarcations à Colmar, notamment dans le secteur de la Petite Venise, ou à l’Ecomusée d’Ungersheim.
Par ailleurs , M. Unterstock propose de Pâques à la Toussaint, au départ de Muttersholtz, des balades sur l’Ill.
Les sorties sont agrémentées d’anecdotes, et d’histoires sur la région, ainsi que sur la faune.
Les coordonnées de M. Patrick Unterstock sont jointes à ce texte.
A l’issue de la conférence et du débat qui s’en est ensuivi, la Société d’Histoire a offert comme de coutume une collation.
Conférence du 15 octobre 2019 par Mme Ségolène PLYER : « de l’Alsace au Banat et retour. Deux cents ans de migrations méconnues ».
13 novembre 2019
C’est dans la salle de la Régence que la municipalité d’Ensisheim avait une nouvelle fois mise à la disposition de la SHE, que s’est déroulée le 15octobre dernier la conférence de Mme Ségolène PLYER, maitresse de conférences à l’Université de Strasbourg.
Dans le cadre d’une recherche en partenariat avec les universités de Fribourg, Mme PLYER s’est penchée sur l’histoire du Banat et de sa population.
Au 18éme siècle, l’empire austro hongrois s’étend sur des territoires qui appartenaient à l’empire ottoman, vaincu, et vidé de ses habitants.
Pour les remplacer, et valoriser une région peu développée à l’époque, des populations originaires d’Alsace, mais surtout de Lorraine (villages de St Hubert, Ste Barbe, Charleville, Mercy..dans le pays messin) ont été encouragées à s’installer en Europe centrale.
Les nouveaux arrivants, en majorité catholiques, sont travailleurs et compétents, ils vivent de leur travail en mettant rapidement en valeur les terres qu’ils occupent.
A la fin de la 1ère guerre mondiale, l’Empire austro hongrois disparait, le territoire du Banat est partagé entre 3 pays que sont actuellement la Roumanie, la Hongrie et la Serbie (ex Yougoslavie).
Afin de conserver leur identité, les Banatais, se sentant peut-être déjà menacés, avaient tenté à l’époque de fonder un département français…(démarche restée vaine)
La population ont continué à prospérer jusqu’à l’avènement de la 2ème guerre mondiale, contraignant 50 millions de personnes à se déplacer.
De langue et de culture germanophones, les Banatais ont été menacés en 1944 dans leur région d’origine par les forces de Tito, ainsi que par l’Armée Rouge, qui a tenté de conquérir les territoires depuis l’Europe du sud-est vers l’Autriche.
Rejetés par la France, méprisés par les Allemands, et menacés d’être internés dans les camps soviétiques, ils ont été condamnés à l’exil qui les a conduits en Autriche, en Allemagne…
Des personnalités comme l’ancien maire de Metz, Raymond MONDON, ainsi que Me ROSAMBERT , juriste à Nancy, ont souhaité défendre la cause des Banatais.
Mais c’est surtout grâce à l’intervention d’un homme d’exception, Robert SCHUMAN, Président du Conseil Français en 1947, sensible à la demande de Jean LAMESFELD président de l’association des Banatais, que la France a pu accueillir dès 1948 10 000 personnes déplacées dont une majorité originaire du Banat.
De plus, la France, qui était en pleine reconstruction, manquait de main d’oeuvre, ainsi que de travailleurs qualifiés.
Les Banatais, dont certains avaient de hautes compétences, notamment en agronomie, ont été vite reconnus pour leur valeur. Ils se sont intégrés très rapidement dans la population, principalement en Alsace (dans l’agriculture et les vignobles notamment).
Cependant, une partie des Banatais (400 personnes environ) s’est installée dans la région d’Avignon, et a repeuplé le village de La Roque sur Perne dans le Vaucluse.
Un débat passionné, et chargé d’émotions et de souvenirs a suivi la conférence.
De nombreuses personnes dans la salle, qui venaient d’Ensisheim et des environs (Soultz, Guebwiller, Réguisheim, Lautenbach..) et descendant de familles Banataises, étaient présentes, et ont pu témoigner de leur histoire encore bien vivante.
Mme PLYER a été particulièrement attentive à ces échanges, susceptibles d’enrichir ses connaissances sur le sujet…
A l’issue des débats une collation a été offerte.
Journées du patrimoine 22 septembre 2019
29 septembre 2019La Société d’Histoire d’Ensisheim s’est mobilisée le dimanche 22 septembre 2019 à l’occasion des Journées du Patrimoine, dont le thème cette année était « Arts et Divertissements ».
C’est sous la forme d’une balade commentée que le public accueilli le matin et l’après-midi a pu se rendre sur les différents sites, et découvrir ou se remémorer les activités passées…
Dans une ambiance amicale, les échanges ont été nombreux, et ont permis d’évoquer des anecdotes et souvenirs pour les uns, ou de susciter de l’étonnement pour les autres…
La promenade s’est conclue par une exposition de photos, ainsi qu’une collation offerte dans la salle Elisatia, qui avait été aimablement mise à disposition.







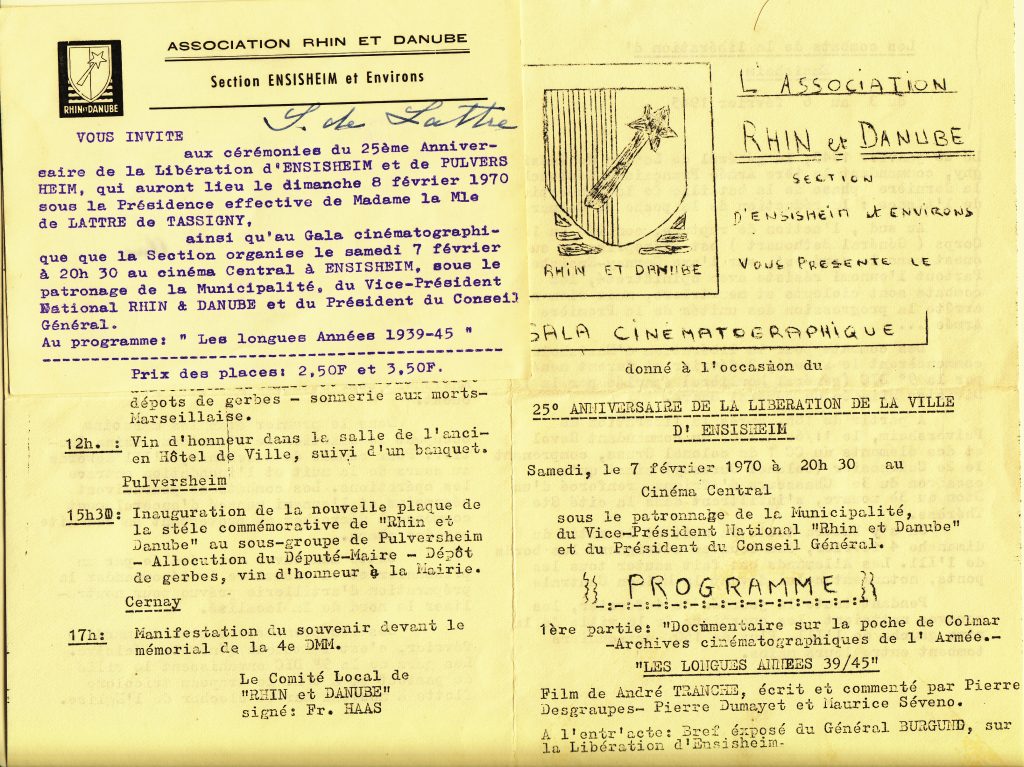



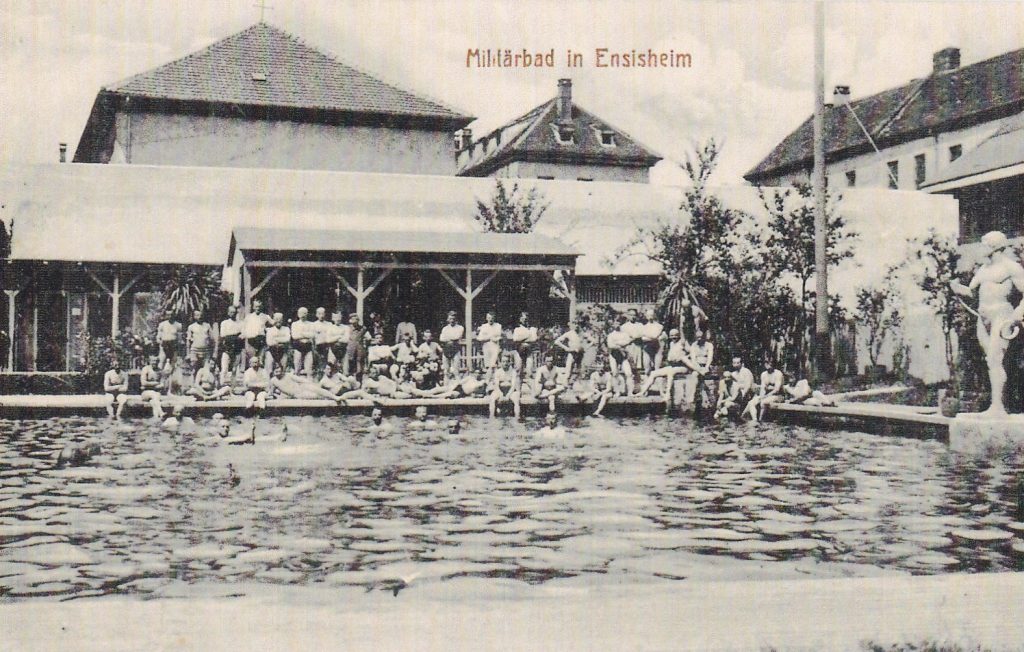
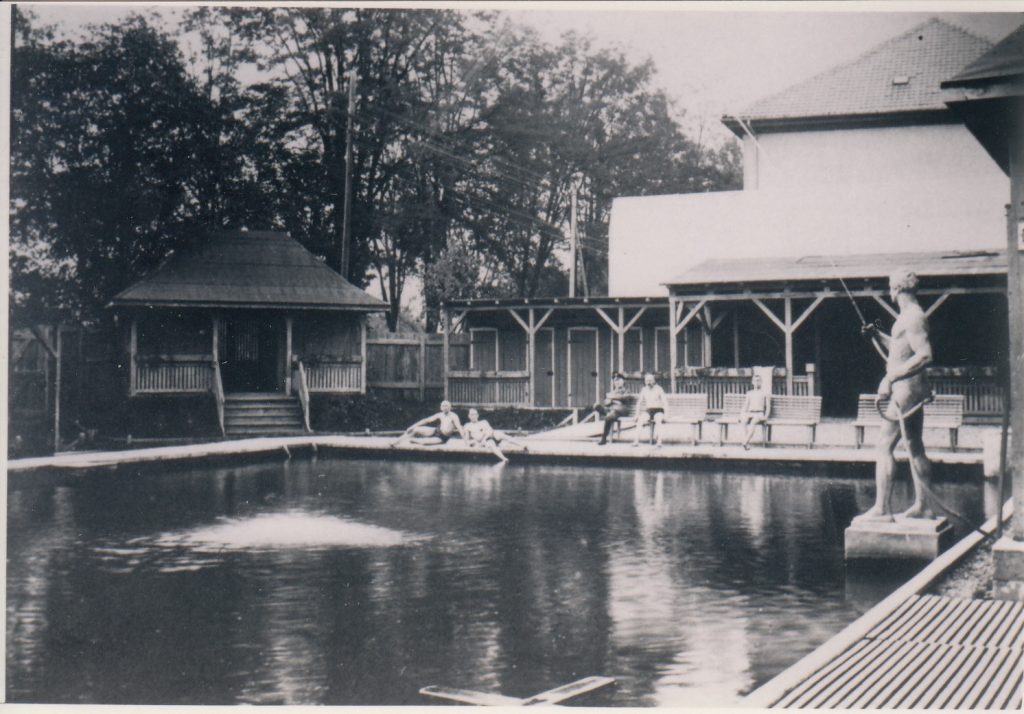


Appel à documents
10 mai 2019Appel à documents
Dans le cadre de ses recherches sur les anciens établissements scolaires d’Ensisheim, la Société d’Histoire d’Ensisheim recherche tout document (écrits, gravures, photos…) concernant les anciennes écoles (filles et garçons ) qui étaient situées sur les sites de l’ancien arsenal (scierie Schmitt), rue de la Liberté (site de la future médiathèque) et rue de la monnaie (anciens établissements Samson) et place de l’Eglise (actuel Hôtel de ville).
Si vous souhaitez communiquer les informations utiles à notre recherche , vous pouvez nous contacter :
frh6768@yahoo.fr 06 58 34 29 18
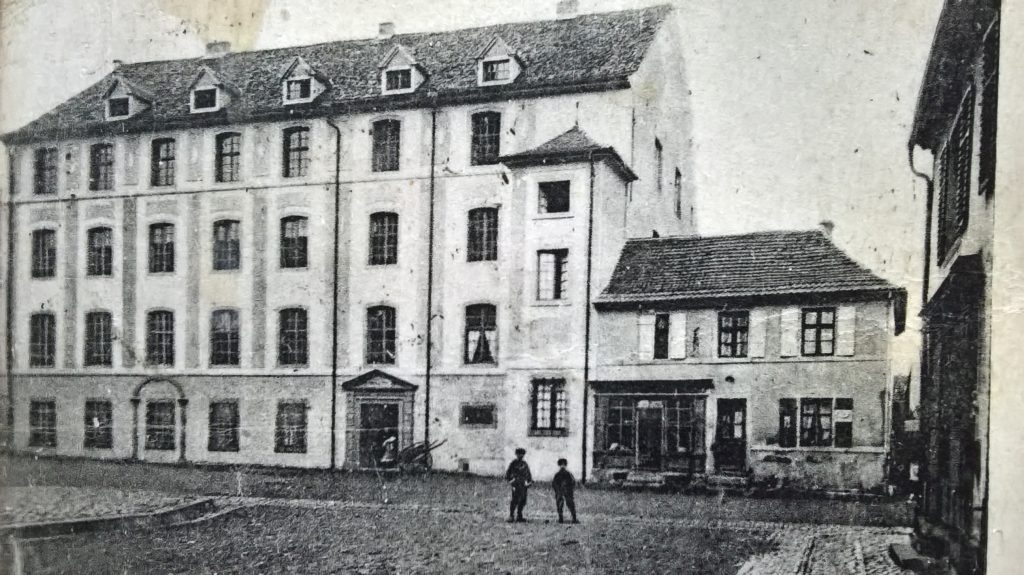

Evénément KALISTOIRE dimanche 2 juin 2019
10 mai 2019La Société d’Histoire d’Ensisheim s’associe à l’événement KALISTOIRE qui aura lieu le dimanche 2 juin 2019, de 9h à 18 heures, au carreau Rodolphe, Rue de Guebwiller à Pulversheim 68840.
L’entrée sera libre.
Des artistes seront présents, ainsi que des musiciens.
Il est également prévu de la restauration sur place, et des animations pour enfants.
Vous êtes cordialement invités à participer à des moments qui seront assurémént conviviaux !
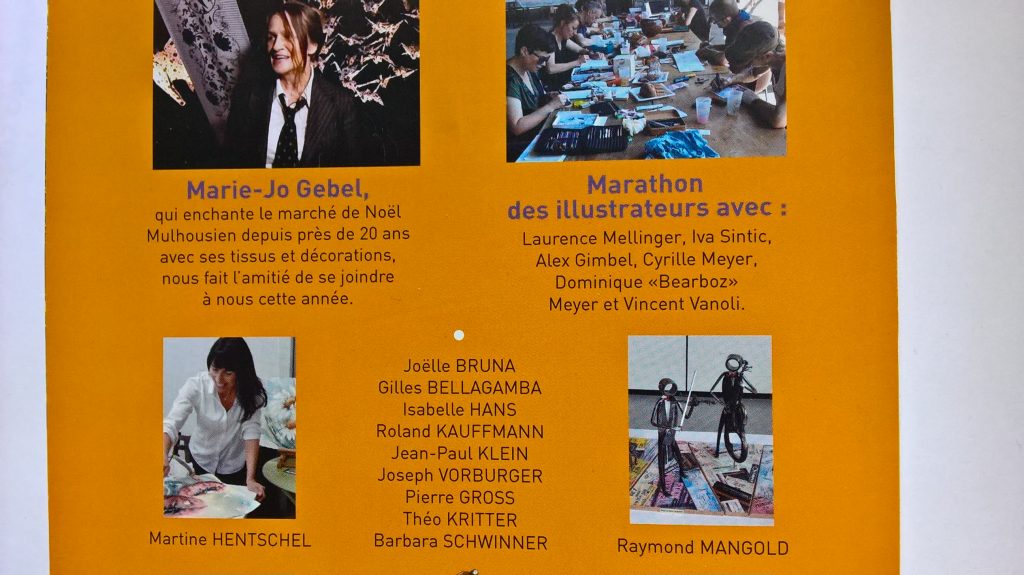
Compte rendu de l’Assemblée Générale de la Société d’Histoire, publié sous réserve de son approbation par l’AG de 2020
11 avril 2019ASSEMBLEE GENERALE
de la SOCIETE D’HISTOIRE ENSISHEIM
en date du 26 mars 2019
au Palais de la Régence à ENSISHEIM

La séance débute à 19 h 20.
1 – Mot d’accueil et rapport du Président.
Le Président Jean Jacques Schwien salue l’assemblée, Monsieur Christophe Sturm, maire – adjoint représentant Monsieur le Maire Michel Habig et Monsieur Philippe Krembel, retenus par ailleurs, et remercie pour la mise à disposition des salles de la Régence pour nos conférences. Il dit son plaisir de retrouver ces lieux réaménagés.
Il remercie la presse toujours présente à nos assemblées générales, les correspondants pour leur travail fidèle de journalistes. Il signale que toutes nos conférences sont régulièrement annoncées, ce qui contribue fortement au succès remporté.
Il demande une minute de silence pour les membres décédés au cours de l’année et notamment pour Monsieur Yves Pluen.
2 – Procès – Verbal de la dernière assemblée générale.
Le procès -verbal de cette Ag, qui s’est tenue le 10 avril 2018 à la Maison Paroissiale à Ensisheim, a été rédigé par Gabrielle Lammert . Il a été transmis aux membres en même temps que la convocation. Le président demande à l’assemblée si elle a des remarques à faire. Personne ne se manifestant, ce PV est adopté à l’unanimité.
3 – Rapport du trésorier et cotisation.
Notre trésorier, Mr. Philippe Drexler, présente les comptes en détail : recettes, dépenses, intérêts, solde final.
Les réviseurs aux comptes ayant vérifié toutes les pièces justificatives et constaté l’exactitude des comptes, ils demandent à l’assemblée de donner quitus au comité pour la bonne gestion. Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
Pour l’exercice 2019, l’assemblée renouvelle le mandat de réviseur aux comptes de Mr. Paul Deyber et de Mr. Denis Buzer.
Le maintien de la cotisation annuelle, dont le montant est de 10 € par personne, est mis au vote et approuvé à l’unanimité.
Le président invite les personnes présentes à s’acquitter de leur cotisation à l’issue de l’AG auprès du trésorier.
4 – Renouvellement du Bureau.
Les membres suivants son renouvelés pour une durée de 3 ans :
Madame Gabrielle Lammert
Monsieur Maurice Gardini
Monsieur Jean-Jacques Schwien
5 – Rapport d’activités et projets.
- Le président rappelle les activités habituelles et courantes marquant la vie de toute association, comme les réunions de bureau, les échanges d’informations, la participation à l’AG de la FAE.
- La Société a également participé à la journée annuelle de Kalistoire, organisée sur le carreau Rodolphe, grâce à l’implication de Maurice Gardini et du bureau.
- Pour les Journées du Patrimoine 2018, la Société a organisé une visite guidée de nous permettant de découvrir les édicules du centre – ville, par le biais d’une visite commentée des petits monuments insolites.
d) Nous avons aussi organisé des conférences qui ont attiré un public nombreux :
* L’agriculture alsacienne à l’époque moderne, une identité et un modèle, par Mr. Jean Michel Boehler de l’Université de Strasbourg.
* La vie quotidienne de la noblesse alsacienne au XIXe siècle, par Marc Glotz, Vice-président de la Société d’Histoire Sundgauvienne.
* D’un donjon d’Alsace à l’autre, par Mr Jean-Marie Nick , Président de l’association Pro Hugstein.
* La forêt , un espace vital. Le regard d’un historien, par Mr Philippe Jehin, docteur en histoire.
* Lorsque l’Alsace était bourguignonne. Rencontre avec Pierre de Hagenbach, bailli de Charles le Téméraire, par Gabrielle Claerr-Stamm présidente de la Société d’Histoire du Sundgau, conférence qui clôturera notre Assemblée Générale de ce soir.
e) Notre commune a aussi fait l’objet de nouvelles découvertes archéologiques. Les fouilles du Reguisheimerfeld ont mis en évidence le passé important de notre localité à tout point de vue. Les vestiges du Mésolithique ou l’époque dite aussi des chasseurs-cueilleurs (5 à 10 000 ans av. J.-C.) de même qu’un village d’agriculteurs de l’Antiquité tardive (300/400 ans ap. J.-C.) en sont les éléments les plus remarquables. Ces fouilles feront l’objet d’une présentation officielle après le rendu du rapport.
f) La démolition annoncée de l’Ecole Jacques Baldé a, de même, permis de faire des découvertes archéologiques fort intéressantes, portant cette fois sur la période médiévale et moderne en coeur de ville, avec notamment la mise au jour d’un atelier de fonderie de cloches et surtout d’un trésor de Thalers enfoui certainement pendant la guerre de Trente Ans (vers 1630). Parallèlement, Francis Hans, Jean-Luc Clausse et Martin Misslin ont continué leurs travaux sur la documentation d’archives de cette ancienne école des garçons.
g) Notre Société poursuit également le travail de mémoire avec les scolaires en partenariat avec les associations patriotiques, grâce à l’engagement de Francis Hans.
h) Le président nous informe avoir reçu un courrier d’une personne détenue à la Maison Centrale d’Ensisheim qui s’intéresse fortement à l’histoire de cette prison pendant la Seconde Guerre Mondiale. Les archives de cette époque se trouvant à Berlin la consultation n’est pas aisée. Cette demande sera un objectif de recherche pour la SHE.
i) Le président est heureux d’annoncer la création de notre page sur le site internet de la FAE. Il remercie la Fédération pour cet outil de communication collectif mis à la disposition des associations. Notre page est pilotée par Jean Luc Clausse. On y trouve nos annonces d’actualités puis leur compte-rendu de même que des dossiers de fond sur l’histoire de la commune.
j) Le président annonce le thème national des Journées du Patrimoine des 21-22 septembre 2019, Les lieux de convivialité – art et divertissements, lieux que Notre Société illustrera localement avec un programme que les membres et sympathisants découvriront en début d’automne.
6 – Questions diverses.
A la fin de la séance, le président donne comme de coutume la parole à la salle.
Mr. Roland Kittler, président de la FAE, félicite l’association pour son dynamisme. Il note la belle fréquentation des conférences et est très heureux de voir les membres assister de plus en plus nombreux à l’AG. Il nous dit sa satisfaction de voir que nous réfléchissons sérieusement à la publication de nos différents travaux. Mr. Kittler nous annonce aussi qu’il quitte la présidence de la FAE.
Le président Jean-Jacques Schwien le remercie chaleureusement pour tout le travail accompli durant ces nombreuses années à la tête de la FAE, pour sa fidélité envers notre société, son soutien et ses précieux conseils. Il lui souhaite donc une belle « retraite associative ».
La parole est donnée à Mr. Christophe Sturm, représentant la municipalité.
Mr. Sturm est heureux de constater que la SHE est une société qui se dynamise et se pérénise. Il nous félicite pour la qualité des conférences proposées et qui, au vu de l’assistance de plus en plus nombreuse, répond à la demande de nos membres et nombreux sympathisants. Il exprime son vœu le plus cher d’instaurer un partenariat accru entre la ville et la SHE sur de nombreux sujets et projets et conclut en souhaitant bon vent à la SHE.
Le président Jean-Jacques Schwien remercie Mr Sturm pour ses paroles encourageantes et est très heureux et impatient de pouvoir travailler en partenariat avec la ville. Il souhaite en particulier que nous puissions nous rencontrer avec Mr. le Maire pour évoquer des conférences communes sur les découvertes archéologiques de premier plan de ces dernières années.
Il remercie encore l’ensemble des membres du bureau pour tout le travail accompli au cours du dernier exercice et se dit très fier d’être entouré par des personnes motivées et passionnées par l’histoire de leur ville.
La séance est levée à 20h.
Le président invite ensuite l’assistance à participer à la conférence de Madame Gabrielle Claerr -Stamm, Présidente de la Société d’Histoire du Sundgau sur le thème :
« Lorsque la Haute Alsace était bourguignonne. Rencontre avec Pierre de Hagenbach, bailli de Charles le Téméraire ».
Fait à Ensisheim le 28 mars 2019
| Gabrielle Lammert Secrétaire de séance | Jean-Jacques Schwien Président |
Conférence du 26 mars 2019, par Mme Gabrielle CLAERR STAMM « Lorsque l’Alsace était bourguignonne, l’histoire de Pierre de Hagenbach »
6 avril 2019Notre Assemblée générale annuelle, tenue ce mardi 26 mars 2019, a été agrémentée comme de coutume par une conférence dans la salle de la Régence, mise une nouvelle fois à notre disposition par la Ville d’Ensisheim.. Cette fois, notre Société a accueilli Mme Gabrielle CLAERR STAMM, présidente de la Société d’histoire du Sundgau, pour évoquer l’histoire de Pierre de Hagenbach, un personnage qui s’est illustré dans notre région au 15ème siècle.
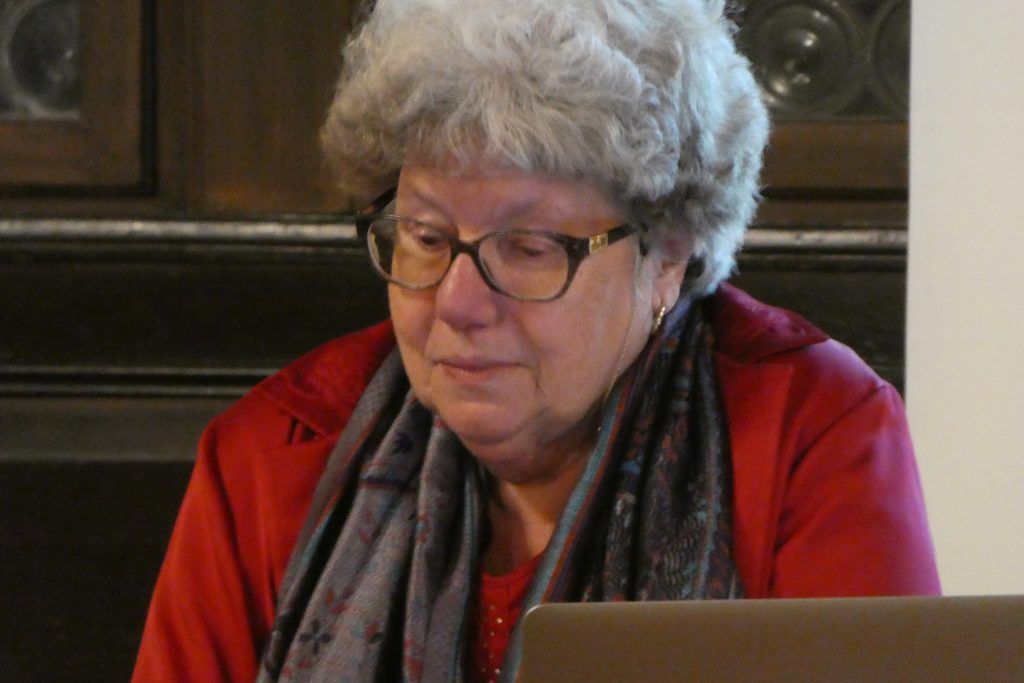

Pierre de Hagenbach est né vers 1420, sans doute à Thann, à une époque charnière entre le Moyen Âge finissant et les débuts de la Renaissance. Plusieurs chroniques manuscrites, puis imprimées ont diffusé des éléments de la vie tourmentée de ce chevalier.
Issu d’une famille de petite noblesse (citée dès 1276), qui possédait un château dans le village éponyme du Sundgau, Pierre de Hagenbach a passé son enfance entre l’Alsace de son père, et la Franche-Comté d’où était originaire sa mère (château de Belmont).
Pierre de Hagenbach a donc grandi dans une région convoitée à la fois par les Habsbourg et le duché de Bourgogne. Il était parfaitement bilingue, qualité qui lui a été particulièrement utile dans le déroulement de sa carrière…
Attiré par les fastes de la Cour, il s’engage comme écuyer au service de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, vers 1440. A l’époque, la Bourgogne, en pleine expansion, s’agrandit progressivement d’une partie des territoires situés en Franche-Comté, Flandres, Artois…
Pierre de Hagenbach participe activement aux guerres de conquête et est rapidement « repéré » par Charles le Téméraire, fils de Philippe le Bon.
Il entre alors au service de Charles le Téméraire en tant que « maître d’hôtel », c’est à dire l’équivalent de grand argentier au service d’une grande maison, dont il assumera la charge avec compétence.
Il sera promu « maitre d’artillerie » en 1466, puis sera nommé chevalier.
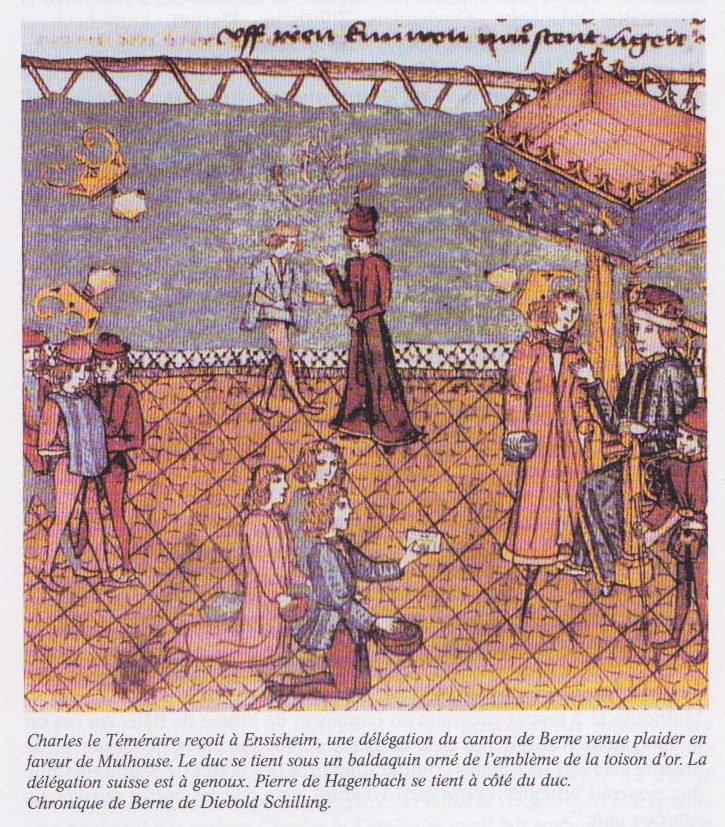
En 1469, à la suite du traité de Saint-Omer, Charles le Téméraire entre en possession des biens de la Maison d’Autriche en Alsace et Forêt Noire.
Pierre de Hagenbach occupera alors les fonctions de « bailli des territoires de Haute Alsace », mis en gage par le duc Sigismond d’Autriche. La souveraineté bourguignonne va progressivement se mettre en place…
Cependant, à partir de 1472, Pierre de Hagenbach doit faire face à des difficultés d’ordre à la fois économiques et politiques. Il dissout des corporations, lève des taxes (sur le vin), mais ordonne également des exécutions en représailles à des révoltes des bourgeois (à Thann, à Ensisheim…). Il devient rapidement impopulaire.
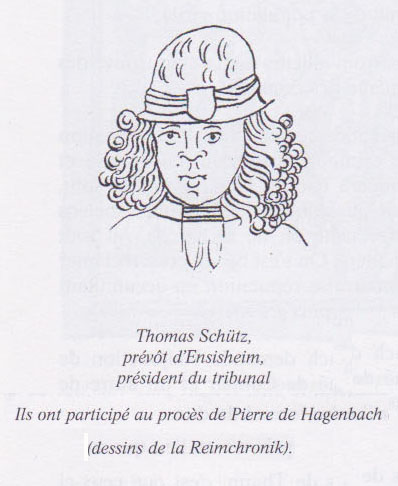
Les bourgeois de la ville de Breisach se révoltent également, il est reproché à Pierre de Hagenbach son comportement tyrannique vis à vis des populations.
Il est alors arrêté et emprisonné dans le Windbruchtor qui existe toujours à Breisach, puis rapidement jugé (le bâtiment « Radbrunnen » est également toujours en place). Torturé puis décapité en place publique le 9 mai 1474, son corps est ramené au village de Hagenbach pour y être déposé dans un caveau à l’église.
En résumé, Pierre de Hagenbach était un homme ambitieux qui a grandi un à un les échelons, au service de ses maîtres Philippe le Bon d’abord, puis Charles le Téméraire ; c’était un homme intelligent et compétent, ainsi qu’un officier zélé.
La plupart des crimes dont il a été accusé ont sans doute été commis « sur ordre », mais peut-être s’était-il rendu coupable d’exactions…
Il a vraisemblablement été exécuté pour raison d’Etat.
La lignée des Hagenbach s’est éteinte au milieu du XVIIIe siècle…
Dans le village de Hagenbach, il ne subsiste plus de traces du château familial qui, au cours des siècles, avait été à plusieurs reprises détruit ou endommagé (séisme de 1356, saccage par les Armagnacs en 1439 et 1444, puis par les Suédois en 1633 durant la Guerre de Trente ans, et enfin par les événements révolutionnaires…).
Les travaux de construction du canal du Rhône au Rhin ont effacé de manière définitive les dernières traces de l’édifice.
A l’issue de la conférence à laquelle avait répondu un public nombreux et attentif, la Ville d’Ensisheim a proposé un vin d’honneur.
Mme CLAERR STAMM a également pu dédicacer son livre « Le destin tragique d’un chevalier sundgauvien au service de Charles le Téméraire ».
Conférence du 26 février 2019, « la forêt, un espace vital, le regard d’un historien », par M. Philippe JEHIN
11 mars 2019La seconde conférence de la société d’histoire, en ce début d’année, s’est tenue mardi 26 février dans le formidable écrin de la Régence, comme à l’habitude, gracieusement mis à notre disposition par la ville d’Ensisheim. Qu’elle en soit remerciée ! Une assemblée fidèle a suivi avec grand intérêt le thème développé par M. Philippe Jéhin, docteur en histoire : La forêt, un espace vital, le regard d’un historien.

Le conférencier a su capter l’attention de tous, rassurant sur l’état général de nos forêts européennes et tout particulièrement celle chère à nos cœurs, la Hardt.
Evoluant d’une notion d’espace économique vital jusqu’à une forêt aux abois à la fin du XVIIIe siècle, passant par une période de réglementation frénétique, tant en Alsace qu’ailleurs, M. Jéhin a parcouru un millénaire d’existence d’espaces forestiers, jugés immuables si l’on s’en tient à un regard superficiel.
C’est ainsi qu’une forêt source économique vitale nous a été décrite d’abord au quotidien, notamment à la période médiévale, où elle était essentielle au foyer pour le chauffage, la cuisine ou encore la construction, puis source de matériaux indispensables à l’industrie, à la défense (les navires, les fortifications) ou à l’habitat et enfin nourricière, avec la chasse, la cueillette ou l’indispensable pâturage du bétail.

Le conférencier a ainsi employé une formule, encore d’actualité : « du berceau au cercueil, l’homme, et notamment l’Alsacien, est entouré de bois ! »
Cette hyperactivité économique a inéluctablement généré des conflits, des jalousies et des abus. D’où la nécessité de réglementer les usages et l’accès à cette ressource qui paraissait infinie. Si la volonté initiale de réglementer était animée de la bonne intention d’attirer et de fixer de nouveaux habitants, elle a inexorablement évolué vers des contraintes et des rejets. Ainsi du droit d’usage de l’espace, créant des notions d’affouage, de marnage ou encore la fameuse mesure des glandées par laquelle les seigneurs fixaient des périodes où chaque famille pouvait laisser pâturer jusqu’à deux porcs dans la forêt. Les conséquences ? Une forêt toujours moins dense, voire clairsemée, et d’innombrables tensions entre l’Etat, les seigneurs et la population.
Comme de nos jours, le pouvoir réagit alors….avec de nouvelles réglementations… cette fois assorties de répressions. L’Empereur Ferdinand 1er promulgue une grande ordonnance forestière en 1557. Le pouvoir de gestion et de contrôle est transféré à un officier d’abord implanté à Habsheim puis à Ensisheim. Mais la forêt continue de se dégrader.
En 1694, après le rattachement de l’Alsace à la France, le nouveau monarque crée deux maîtrises pour les forêts alsaciennes, l’une à Haguenau pour la Basse Alsace et l’autre à Ensisheim pour la Haute Alsace. Ensisheim est donc au cœur du pouvoir, à proximité directe de la plus grande des forêts de la région, la Hardt, gérée par la compagnie de la Hardt depuis le Moyen Age. Mais la ressource reste soumise aux pressions seigneuriales et aux exigences du pouvoir royal. En 1730, la monarchie reprend la main. C’est l’émergence d’une notion encore inconnue : la sylviculture.
Dans une dernière partie, le conférencier présente une forêt aux abois au XVIIIe siècle.
Réserve foncière, elle a toujours subi de plein fouet l’essor démographique depuis plus d’un millénaire, reculant progressivement sous les assauts des besoins agricoles ou d’expansion urbaine.

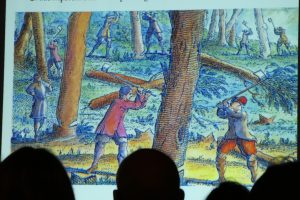
L’écobuage et essartage étaient l’essentiel de ce qui dégradait et surtout faisait reculer la forêt depuis l’aube de l’agriculture, avec une accélération au milieu du Moyen Age ; l’industrialisation, ensuite, dès les débuts de l’époque moderne, avec le bois nécessaire aux hauts fourneaux, va avaler des kilomètres carrés de forêt, le processus atteignant un paroxysme au XIXe siècle, avant le développement de l’usage du charbon et l’arrivée de la fée électricité. Cette déforestation a d’ailleurs provoqué d’importantes inondations, l’eau dévalant des pentes nues de nos montagnes sans pouvoir s’infiltrer dans les sous-bois, la dernière en date étant celle de 1910. Mais les pouvoirs publics ont d’emblée perçu les dangers et mis en place progressivement des mesures destinées à juguler le phénomène.
Il aura fallu attendre 1827, et la création du code forestier pour qu’enfin le massacre cesse. Le pâturage est interdit et une politique de reboisement est mise en œuvre. La révolution industrielle réduit les besoins en bois au profit de nouveaux matériaux. Les populations urbaines supplantent celles du monde rural. Sous le second Empire et la IIIème République le reboisement est massif. Le retour de l’Alsace à la France, en 1918, ne ralentit pas l’évolution, car les autorités allemandes étaient animées des mêmes intentions. Ces dernières avaient même instauré le réputé modèle prussien, avec cet alignement remarquable des arbres que l’on retrouve un peu partout, optimisant ainsi l’espace.
C’est donc avec une note optimiste que notre conférencier a conclu, soulignant que, contrairement à de nombreuses contrées de l’hémisphère sud, la surface forestière française a plus que doublé depuis la Révolution, évoluant depuis 7 millions d’hectares pour en atteindre aujourd’hui plus de 15 millions. A l’aube du XXIe siècle, la forêt retrouve donc un intérêt écologique, économique, voire récréatif.
Pendant des siècles, elle joua un rôle vital pour toutes les catégories sociales. Gageons que l’avenir qui lui semble promis sera désormais….florissant !
La prochaine conférence de la SHE se déroulera le 26 mars 2019 à 20h15, toujours dans la salle de la Régence. Nous croiserons l’histoire de Pierre de Hagenbach, bailli de Charles le Téméraire, chef de guerre et légende noire ayant marqué l’histoire de l’Alsace. Gabrielle CLAER-STAMM, présidente de la Société d’Histoire du Sundgau, et auteure d’un ouvrage sur le sujet, nous exposera par le menu la vie de ce chevalier sundgauvien controversé.
Mme Claer-Stamm dédicacera d’ailleurs son livre après la conférence.
La conférence sera précédée de l’assemblée générale de la SHE, à 19h.
Conférence à la Régence de Jean Marie NICK, le 29 janvier 2019
5 février 2019 « D’un donjon à l’autre »
« D’un donjon à l’autre »
Le cycle des conférences de la Société d’Histoire d’Ensisheim a repris le 29 janvier dernier dans la prestigieuse salle de la Régence, fraichement rénovée, avec comme intervenant Jean Marie NICK, amateur des châteaux forts.
Le public est venu en nombre pour écouter ce passionné du Moyen Age exposer son étude sur les différents types de donjon dont quasiment chaque forteresse était pourvue…
La variété de ces constructions, du nord au sud de l’Alsace, et au-delà (Lorraine, France, Europe) était liée à différentes affectations; de simple beffroi ou tour de guet, il savait aussi être un logis confortable…
Selon le choix de leur constructeur, et les exigences liées aux terrains sur lesquels ils étaient construits, les donjons pouvaient être de forme ronde, carrée, ou pentagonale…et même heptagonale .
Tous avaient comme point commun le symbole de puissance et d’autorité de leurs occupants.
Nous pouvons encore au travers de nos balades, admirer, découvrir et rêver devant ces témoins devenus parfois fragiles, d’une période pour laquelle nous sommes toujours nombreux à nous passionner.
Pour plus d’infos, voir le site web qui permet désormais d’organiser ces ballades https://www.chateauxfortsalsace.com
Et pour ceux qui s’intéressent au château d’Ensisheim, il vous est possible de lire l’article sur le lien ci contre: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9751359v/f47.image
Le cycle des conférences va se poursuivre et le prochain rendez-vous est fixé au 26 février prochain, toujours à la Régence, avec M. Philippe JEHIN qui nous parlera de « La forêt, un espace vital, le regard d’un historien »
Découverte d’un dépôt monétaire sur le site de l’ancienne école Baldé à l’été 2018
22 novembre 2018Des fouilles on eu lieu récemment sur le site de la future médiathèque d’Ensisheim (anciennement école Baldé détruite à l’automne 2017), effectuées par « Archéologie d’Alsace ».
La Société d’Histoire d’Ensisheim y a été associée dès le début des travaux, pour apporter des compléments documentaires, en particulier sur la construction de l’école primaire.
Des bâtiments anciens ont ainsi pu être localisés grâce à la mise à jour de fondations de maisons d’habitation, de fermes, de caves, de puits, latrines….

Des éléments témoignant du passage des hommes depuis le Moyen Age ont été identifiés, et sont en cours d’étude (carreaux de poêle en faïence, outils, vaisselle…).



Des « moules à cloches » ont également été mis au jour, dont on peut penser qu’ils ont servi lors de la construction de l’église vers 1860.

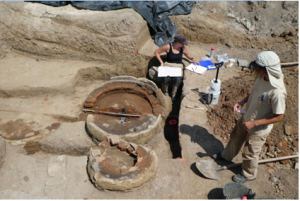
Mais une trouvaille exceptionnelle a été réalisée au travers de la mise à jour d’un dépôt monétaire composé en grande partie de thalers frappés à Ensisheim.
On peut rappeler qu’Ensisheim a disposé d’un atelier monétaire entre 1582 et 1634. Cet atelier, fondé par les Habsbourg, était alimenté par les mines d’argent des Vosges au moment de leur plus grand développement. Son emplacement précis est inconnu mais se situait dans l’actuelle rue de la Monnaie. Son activité a été très importante, avec par moments, plusieurs dizaines de milliers de pièces par an. Le fleuron de cet atelier était le thaler, une grosse pièce d’argent faisant suite à l’ancien florin médiéval.
La découverte effectuée provient sans doute d’une bourse (cuir ou tissu) dissimulée dans une cachette aménagée sous le plancher d’habitation. Elle est composée d’une soixantaine de thalers en argent, dont une vingtaine frappés à Ensisheim, les autres issus de divers ateliers habsbourgeois et germaniques. Il comprend également une centaine de pièces divisionnaires appelées « batz » (en alliage d’argent et de cuivre), provenant pour la plupart de Murbach et Lure.
La période des monnaies trouvées (1618-1627) correspond aux débuts de la guerre de Trente ans (1618-1648) qui a ravagé l’Europe et décimé les populations. Ensisheim n’a pas été épargnée puisqu’elle a été à plusieurs reprises, pillée, saccagée, rançonnée, brûlée…successivement par les Suédois, les Autrichiens, les Lorrains et les Français. Au sortir de la guerre, il n’y restait plus guère d’habitants et sur 300 maisons, seule une trentaine restait encore debout…

On peut donc imaginer que durant ces temps d’incertitude, la personne, propriétaire du « trésor » mis à jour en juin 2018, aura voulu dissimuler ses économies afin de les préserver des pillages possibles, et de pouvoir les récupérer, plus tard..
Nous savons désormais qu’elle ne les a jamais retrouvés…
journées du patrimoine
20 septembre 2018




 Les journées du patrimoine ont été l’occasion pour la SHE de se mobiliser ce dimanche 16 septembre 2018 sur le thème « Art et Partage ».
Les journées du patrimoine ont été l’occasion pour la SHE de se mobiliser ce dimanche 16 septembre 2018 sur le thème « Art et Partage ».
De nombreux petits édifices et monuments qui font partie du paysage quotidien dans la ville, et qui bien souvent passent inaperçus, ont ainsi été mis en valeur au travers d’une promenade qui a pu se dérouler dans les meilleures conditions.
La majorité des visiteurs étaient originaires de la ville ou de ses environs, mais beaucoup d’entre eux ont été étonnés par la découverte de certains édicules qu’ils croyaient connaître, ou qu’ils ont découverts à l’occasion de cette belle journée de fin d’été ; des commentaires et anecdotes ont pu être échangés tout au long de la balade proposée.
Le parcours organisé avait démarré devant le monument du baromètre situé Faubourg de Belfort et a pris fin au « lavoir » rue Foch, passant, notamment, par le bunker, Saint-Jean de Népomucène ou encore les puits, calvaires et autres sculptures contemporaines.
A l’issue de cette promenade instructive, un rafraichissement a été offert aux visiteurs par le président de la SHE.
Annuaire des associations
- Culturelles La catégorie associations culturelles rassemble toutes les associations qui s’intéressent de près ou de loin au spectacle vivant, arts visuels, les médias associatifs ou le patrimoine tout ce qui englobe la culture en générale.
- Diverses Retrouvez ici toutes les Associations au service de la communauté. Issues toutes de domaines différents, qu'elles soient caritatives, de notoriété publique ou privées, cette session est là pour toutes les représentées.
- Loisirs Découvrez ici les diverses Associations de Loisirs du Canton d'Ensisheim. Venez partager avec d'autres adhérents la passion de vos loisirs. Qu'ils soient de nature créatifs ou divertissants, le Canton d'Ensisheim vous propose une belle palette d'activités loisirs sous diverses formes à partager pendant vos temps libres.
- Patriotiques Découvrez la plupart des Associations Patriotiques du Canton d'Ensisheim telles que l'Association des Anciens Combattants,etc...
- Sportives Retrouvez dans cette catégorie l'ensemble des Associations Sportives du Canton d'Ensisheim. Partagez votre passion du Sport avec d'autres adhérents et découvrez des associations basées sur divers sport tels que le foot, le tennis, le badminton, la natation, la plongée et bien plus!
DERNIERS ÉVÉNEMENTS À ENSISHEIM EN IMAGES
Metéo sur ensisheim
Bonne fête aux :
La fête du jour sur votre site avec fetedujour.fr